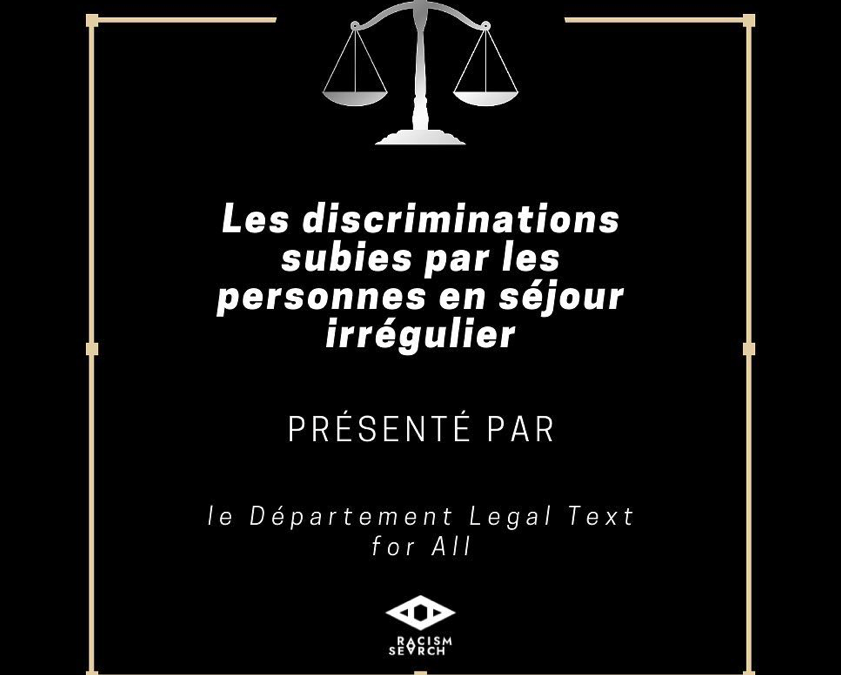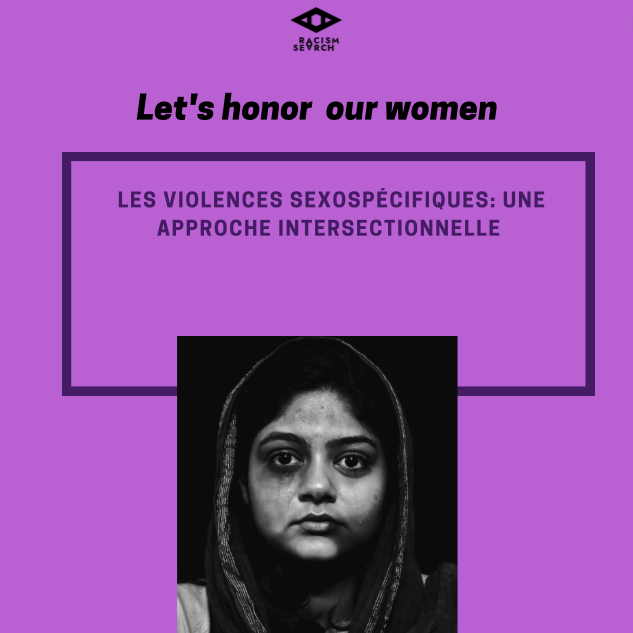
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Intersectionalité
les violences sexospécifiques: une approche intersectionnelle

Sneha SIvarjan, une photo en noir et blanc d’une femme portant un foulard, Unsplash, publié le 27 septembre 2021, disponible sur https://unsplash.com/pt-br/fotografias/uma-foto-em-preto-e-branco-de-uma-mulher-usando-um-lenco-AhfrQsQkceU
Introduction
TW : violences sexuelles
Chaque jour des violences sexuelles et de genre sont perpétrées majoritairement par des hommes à l’encontre de femmes[A]. Si cette réalité est de plus en plus connue, médiatisée et combattue, il reste encore difficile d’obtenir des sources documentant l’ampleur et l’impact de ce phénomène sur les femmes racisées et donc de mesurer l’aspect systémique de ces violences dans une approche intersectionnelle[B].
Au travers de cet article, nous avons décidé de faire le jour sur ces questions et donc, plus précisément, sur les violences sexospécifiques (c’est-à-dire les violences sexistes, sexuelles, et de genre) à l’égard des femmes racisées ainsi que l’accompagnement de ces femmes au niveau institutionnel (police, justice).
Si, évidemment, les éléments que nous mettrons en lumière pourraient, chacun, faire l’objet d’un article, notre objectif, ici, est de souligner la dimension globale et systémique.
Au vu du sujet traité, n’hésitez pas à interrompre votre lecture si celle-ci devenait inconfortable/difficile et à prendre un moment pour prendre soin de vous.
1. Violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes racisées
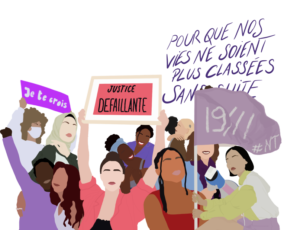
photo du site https://www.noustoutes.org/manif2022/
À la racine des violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes racisées, il y a la question des stéréotypes, préjugés et stigmates qui leur sont accolés et qui favorisent d’autant plus la production de discriminations et de violences[C].
Ainsi, les stéréotypes vis-à-vis des femmes racisées, notamment sur leur sexualité, dans nos sociétés belges et françaises sont des stéréotypes directement liés à notre passé colonial (et au colonialisme encore actuel). Rokhaya Diallo et Grace Ly illustrent cela en démontrant que la fétichisation des femmes racisées découle directement de la colonisation, période durant laquelle les colons ont cherché à asseoir leur domination de plusieurs manières notamment au moyen de viols [D]. Françoise Vergès fait également le lien avec les pratiques esclavagistes et coloniales, où les femmes racisées étaient considérées comme des objets sexuels [E].
Un ensemble de préjugés se sont construits à partir de ce terreau fertil qu’a été la colonisation pour les violences sexuelles et de genre. Sur base de leurs corps, de leurs couleurs de peaux, de leurs traits physiques, les femmes racisées sont tantôt rejetées tantôt hypersexualisées; tantôt considérées comme douces et dociles – faciles à dominer, tantôt considérées comme puissantes sexuellement, animales – qu’il faudrait “dompter”. [F]
Ces stéréotypes se sont insinués partout, participent aux imaginaires collectifs autour de la sexualité, d’autant plus que l’industrie de la pornographie s’en fait l’écho. À titre d’exemple, la requête « beurette » est aujourd’hui l’une des plus courantes dans les moteurs de recherche des sites pornos. [D]
Au-delà de participer à l’essentialisation des femmes racisées, la perpétuation de ces clichés conduisent à ce que ces femmes soient victimes de plus de violences.
Selon Amnesty International en effet, les femmes noires ont 84% de risque en plus d’être mentionnées dans un message abusif ou problématique que les femmes blanches sur les réseaux sociaux.[G]
Dans le cadre d’une enquête dont la commune d’Ixelles est à l’initiative, liée aux agressions à Ixelles et au mouvement #balancetonbar, 70,7 % des personnes rapportant se sentir discriminées en raison de leur origine ethnique ou culturelle rapportent avoir vécu une ou des violences sexuelles ayant un caractère discriminatoire relatif à l’origine ethnique ou à la culture. 75 % des personnes rapportant se sentir discriminées en raison de leur couleur de peau rapportent avoir vécu une ou des violences sexuelles ayant un caractère discriminatoire. Dans ce même rapport, il a été reconnu que les caractéristiques discriminatoires additionnelles de ces agressions sexuelles opèrent comme un multiplicateur de violence et aggravent le traumatisme vécu par les personnes concernées. [H]
Les femmes racisées sont impactées par toutes les formes de violences, en ce compris les violences conjugales. [I]
2. Violences sexuelles à l’égard des personnes en parcours migratoire

Mika Baumeister,personnes en T-shirts jaunes et roses, Unsplash, publiée le 24 novembre 2020, disponible surhttps://unsplash.com/fr/photos/personnes-en-t-shirts-jaunes-et-roses-YaHlnh6ItjA
Sans que les éléments détaillés ci-avant ne soient considérés comme invalides, il semblait important de considérer la situation spécifique dans laquelle se retrouvent les femmes en parcours migratoire. En effet, ces personnes se retrouvent dans des contextes de vulnérabilité très importants que cela soit durant leur parcours ou dans leur pays d’accueil. [G]
Si leur condition spécifique est prise en compte par différents instruments juridiques internationaux, tels que la Convention d’Istanbul ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, force est de constater qu’en pratique, elles restent confrontées à de nombreuses violences. Pour ne se limiter qu’à la Belgique, le dernier rapport du GREVIO sur la situation dans notre État, souligne la nécessité de revoir en profondeur les lois et politiques en matière d’immigration en vigueur car, en l’état, elles ne garantissent pas une protection suffisante et effective en matière de violences faites aux femmes. [J]
3. La réponse institutionnelle face à ces violences:
Si les femmes racisées sont donc particulièrement visées par des violences sexistes et sexuelles, la réponse institutionnelle à ces violences en constitue une elle aussi.
En effet, au-delà des difficultés rencontrées par toutes les femmes dans le dépôt d’une plainte ou dans le processus de la justice pénale, ce processus est d’autant plus difficile pour les femmes racisées dans un contexte plus global de violences policières et de justice raciste.
Pour beaucoup de femmes racisées victimes de violences sexistes et sexuelles, le choix de porter plainte ou non est grandement influencé par l’impact négatif des expériences vécues dans les autres sphères de leur vie sociale et la méfiance envers les services de police.
Cette méfiance serait, entre autres, le résultat de nombreux phénomènes, comme la discrimination systémique des personnes racisées, la surreprésentation de ces personnes parmi les victimes de violences policières, le profilage et la surveillance policière accrue de ces populations.
En outre, plus spécifiquement pour les femmes en parcours migratoires, cela est dû à la précarité du statut, la méconnaissance du fonctionnement du système juridique, l’isolement, les défis engendrés par le processus migratoire, la discrimination à l’égard de ces femmes ou certaines mauvaises expériences avec les forces de l’ordre dans le pays d’origine.
Quand elles décident de porter plainte, ces femmes sont encore susceptibles de subir des entraves au bon fonctionnement de la procédure judiciaire.
En effet, toutes victimes de violences sexistes et sexuelles fera fort probablement face à une banalisation des violences sexospécifiques, la culture du viol, le manque de connaissance sur les processus de victimisation, l’insensibilité et les attitudes culpabilisatrices de la part des acteurs et actrices du système judiciaire et les longs délais.
A cela s’ajoutent des obstacles spécifiques aux personnes racisées en raison de l’intériorisation de certains stéréotypes. [K]
Les stéréotypes que nous mentionnions précédemment sont également ici à l’œuvre. “Les femmes noires sont perçues comme plus irrationnelles, plus résistantes à la violence et plus agressives que les femmes blanches (Richie, 2000). Parce que la « bonne victime » de violence est perçue comme la victime d’une violence unilatérale de contrôle, la « bonne victime » ressemble plutôt à une femme blanche, tandis que les femmes noires voient les violences qu’elles subissent légitimées par leurs stéréotypes raciaux de comportement et souffrent d’un déficit de crédibilité comme victimes auprès des associations et surtout du système judiciaire ; les femmes noires passent donc pour de « mauvaises victimes »(West, 2004 ; Sokoloff et Dupont, 2005). La focalisation sur la dimension genrée de la domination a fonctionné aux dépens des dimensions économiques et raciales”[I].
Conclusion
Cet article a démontré une fois encore la nécessité d’appliquer une lecture intersectionnelle aux différents phénomènes sociaux, en l’occurrence les violences sexospécifiques. Cette approche est nécessaire tant au niveau théorique qu’au niveau pratique et donc à mobiliser dans les outils de lutte, de prévention et de sensibilisation
Sources:
[A] Nous utilisons les mots femmes pour englober toutes les personnes subissant ou ayant subi différentes formes de sexisme : les femmes cis, les femmes trans, ainsi que toutes les victimes de sexisme qui ne s'identifient pas en tant que femmes comme les personnes AFAB et les personnes non-binaires.
[B] Voy. les articles déjà présents sur la page “Racism Search” abordant la question.
[C] HAMEL, C., « La sexualité entre sexisme et racisme : les descendantes de migrant·e·s du Maghreb et la virginité », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, no. 1, 2006, pp. 41-58.
[D] DIALLO, R. et LY, G., « La geisha, la panthère et la gazelle », Podcast Kiffe ta Race, épisode 3, 2018.
[E] VERGES, F., Un féminisme décolonial, La fabrique Éditions, 2019.
[F] Voy. les articles déjà présents sur la page “Racism Search” abordant la question de l’hypersexualisation et des préjugés.
[G] Amnesty International, « Des recherches participatives sur Twitter révèlent l’ampleur choquante des violences en ligne à l’égard des femmes », Communiqué de presse, 18 décembre 2018, disponible sur: https://www.amnesty.org/fr/latest/press-release/2018/12/crowdsourced-twitter-study-reveals-shocking-scale-of-online-abuse-against-women/ (consulté le 6 février 2023).
[H]Egerieresearch, « Diagnostic intersectionnel du vécu des femmes, des personnes sexisées, racisées et faisant partie de la communauté LGBTQIa+ dans le milieu festif et les bars en particulier », Rapport, Avril 2022, disponible sur : https://ds.static.rtbf.be/article/attachment/11005607/c/3/f/f9d6d25b559f8c8ad375aa4f42db9cba.pdf (consulté le 6 février 2023).
[I]BONNET, F., « Violences conjugales, genre et criminalisation : synthèse des débats américains », Revue française de sociologie, vol. 56, no. 2, 2015, pp. 357-383.
[J]GREVIO, « Rapport d’évaluation de référence - Belgique », Conseil de l’Europe, 21 Septembre 2020.
[K]THIBAULT, S., PAGÉ, G. et BOULEBSOL, C., Justice pour les femmes marginalisées victimes de violences sexospécifiques. Ce que la littérature et les intervenantes nous apprennent, Québec, 2022.
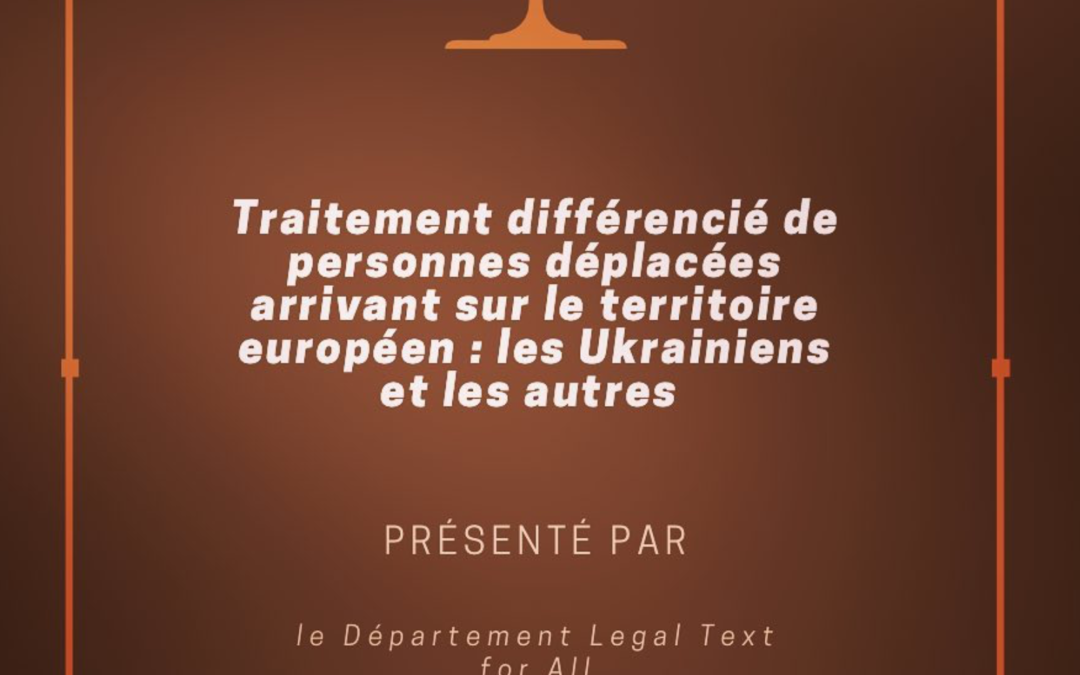
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Débat, Droits, Général, Legal Text For All

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Débat, Général, Sous représentation
Le milieu de l’art visuel est-il toujours raciste?
Au début du mois, le département content s’est rendu au Musée de l’Afrique Centrale de Tervuren. De cette visite sont nés plusieurs questionnements sur l’art de manière générale: le milieu de l’art visuel est-il toujours raciste ? Et, sur quel maillon de la chaîne, se trouve la discrimination ?
Dans cet article, une attention particulière sera accordée au milieu de l’art visuel. Pour ce faire, définissons d’abord ce que sont les “arts visuels” : il s’agit traditionnellement de la peinture, de la sculpture, du dessin, la photographie mais également le montage vidéo, etc. (1) L’usage du terme “arts plastiques” a été délaissé car il restreint le champ de l’article aux “beaux-arts” et évince dès lors de nouvelles formes d’expressions modernes et contemporaines émergentes.
Bien souvent considérés comme impartiaux, les musées, les galeries ou de tout autre lieu d’exposition rassemblent dans leurs institutions des expressions artistiques. L’ICOM, le Conseil International des Musées créé en 1946 et qui rassemble pas moins d’une centaine de pays, a affirmé en juin 2020 que le musée n’était pas neutre (2). Il s’agit d’une avancée majeure puisque cette même instance a émis une définition du musée reprise par les professionnel·le·s du milieu et a affirmé le rôle de l’institution muséale au sein de la société. Le choix des œuvres, les artistes présentés, les médiateur·ice·s culturels employé·e·s, les membres du personnel… présentent – par leur existence – nécessairement un biais, puisque tout choix amène la renonciation à un autre. L’art au sein des musées, ayant longtemps été vecteur d’une pensée élitiste, a souvent exclu les “subjectivités et les corps non blancs” (3). L’ICOM affirme d’ailleurs que les musées « ont la responsabilité et le devoir de lutter contre l’injustice raciale (…), depuis les histoires qu’ils racontent jusqu’à la diversité de leur personnel » (2).
* Il ne s’agit pas ici de définir ou de limiter à une définition unique ce qu’est une œuvre d’art.
Néanmoins, la réelle déconstruction des personnes chargées de mener à bien la tâche de “décoloniser les arts”** pose question lorsque l’on sait que l’histoire de l’art – toujours étudiée- est plus une « cartographie temporelle périodisée des artistes et des œuvres en Europe de l’Ouest » (3).
« Qu’est-ce qu’un musée décolonial ? Sachant que l’idée même du musée est occidentale. Quelles collections, quels objets, quel mode d’exposition ? La tâche est immense, mais féconde » (4).
Cet article tentera de comprendre les différents rouages sur lesquels travailler la décolonisation de l’art pourrait être intéressant : l’artiste, l’œuvre, les employés du musée. Pour finir, la restitution des œuvres coloniales semble constituer une question inévitable et nécessaire.
- La Sous-représentation des artistes racisés
Comme évoqué dans l’introduction le monde de l’art visible, comme le monde du cinéma ou de la télévision**, est dominé par les personnes blanches. Cette majorité blanche entraîne une vision du monde selon le prisme d’un groupe ethnique privilégié et catégorise les autres types d’art comme “ autres” voire “exotiques” (5). Cela accentue donc le sentiment d’exclusion et d’invisibilité que ressentent les artistes racisés.
Les musées qui ont comme but principal de raconter une histoire, de véhiculer un certain message, doivent émettre des choix précis. Cette sous-représentation d’artistes racisé·e·s insinue une certaine manière de pensée et attire donc un certain type de public, en en excluant un autre (6). Le Conseil des arts du Canada affirmait d’ailleurs déjà en 2015 que la répartition inégale qu’il existe dans le milieu de l’art est « souvent le résultat de réalités historiques rattachées à la conquête, à la colonisation, à la domination culturelle et à l’exclusion systémique » (5).
Le même constat est à faire en Europe, on remarque d’ailleurs qu’il y a très peu de personnes racisées dans les écoles d’art (4). Pourquoi ? S’agit -il d’un désintérêt de ces communautés ? Les filières d’histoire de l’art, sont surreprésentés et enseignées majoritairement par des personnes blanches, masculines et bourgeoises qui adoptent une vision blanche et hétérocentrée de notre société (6). Pour ces raisons, peu de personnes racisées choisissent d’entreprendre ces études, ou si elles le font, plusieurs arrêtent durant leur parcours scolaire.
** Voir notre article “ La sous représentation – manque de diversité “ du 13 décembre 2020.
S’ajoute à cela l’accès au marché de l’art et la visibilité accordée aux personnes racisées. Nous le savons, notre société fonctionne sur un système financier et capitaliste. Dès lors, la question de l’argent est déterminante tant pour les musées que pour les artistes. Or, le budget donné aux artistes racisées et les moyens mis à leur disposition pour visibiliser leur art sont minimes comparés à ceux accordés aux artistes blancs (6).
Comme le relève Toma Muteba Luntumbue, artiste plasticien, commissaire d’exposition indépendant et professeur d’histoire de l’art : avoir une place dans un musée ne suffit pas. Ayant collaboré avec le AfricaMuseum ou le Musée Royal des Beaux-Arts, Monsieur Muteba Luntumbue conclut que ces collaborations finissent toujours ”à votre subalternalisation, sur le plan intellectuel comme sur le plan matériel. Soit parce qu’une catégorie est créée spécialement pour vous y accueillir, soit pour vous marginaliser, on vous rétribue mal ou on ne vous rétribue pas du tout.” (7) Ce n’est finalement qu’en lançant leur propre exposition que les personnes racisées peuvent s’assurer d’être réellement rétribuées et de sortir du rapport colonial qui existe avec les institutions muséales occidentales (7).
Depuis plusieurs années maintenant, des artistes, tel que Jean-François Boclé (d’origine martiniquaise), utilisent leur art pour faire passer des messages politiques et dénoncer le racisme systémique que subissent les personnes racisées dans les anciens pays colonisateurs (4). En faisant part de leur réalité, ils permettent au public d’ouvrir les yeux sur des choses qui, de prime abord, ne les auraient pas marqué. Une véritable diversité des artistes est donc nécessaire pour une représentation réelle de la société moderne.
-
La représentation des personnes racisées dans l’art visuel blanc européen:
Si donc l’histoire de l’art se concentre et valorise les œuvres produites par des blancs, pour des blancs dans un contexte européen, qu’en est-il cependant de la représentation des personnes racisées dans ce type d’art?
C’est en tout cas cette question de départ, qui a fait entreprendre à Naïl Ver-Ndoye et Grégoire Fauconnier leur étude, Noir : entre peinture et histoire (8), où ils étudient plus de 350 oeuvres qui représentent des personnes noires, mais il en existe des milliers rien que dans les collections françaises. Ces oeuvres traversent d’ailleurs toutes les époques puisque l’on retrouve des oeuvres représentant des personnes noires de l’Antiquité à nos jours (9), et des personnes noires de toutes classes sociales (Chevalier Saint-Maurice, Jean-Baptiste Belley…) même si la majorité reste des personnes de classe socio-économique plutôt pauvre (9).
Sans pouvoir revenir sur toutes les analyses qu’ils font dans leur livre, ni de celles formulées dans l’épisode “Représenter les noir.es : le regard blanc” du podcast Vénus s’épilait-elle la chatte (10), plusieurs points d’attention peuvent être soulevés. ![]()
![]()
- La majorité des personnes représentées sur les tableaux sont anonymes. C’est-à-dire qu’on ne sait pas qui elles sont, et que le travail fourni pour trouver ces informations a été insuffisant, voire inexistant. C’est particulièrement marquant lorsque l’on sait que l’identité de la majorité des personnages blancs, même secondaires, est connue. Un exemple frappant, est celui de l’oeuvre Olympia de Manet, peinte en 1863, où figurent une femme blanche et une femme noire l’une à côté de l’autre et seule la femme blanche a fait l’objet d’analyses, de commentaires et de recherches. Ce n’est que très récemment que l’on a pu identifier Laure, la servante noire représentée sur le tableau et en savoir plus sur sa vie (11) .
- Les personnes noires sont rarement le sujet du tableau et occupent généralement le second plan (10). Plus encore, ces personnes ne sont pas toujours représentées pour elles-même mais parfois comme allégories ou symboles.
![]()
![]()
Il faut souligner le travail récent de certains musées, chercheurs et chercheuses qui ont voulu mettre en lumière les personnes noires représentées dans la peinture (12;13), sans que ce travail ne soit pour autant suffisant que pour parvenir à une véritable décolonisation de nos expositions, institutions muséales et vision de l’art dans son ensemble.
- L’absence de travailleurs racisés au sein des institutions culturelles
Si l’on sait que le milieu de l’art est majoritairement blanc, il faut se questionner sur les personnes qui mettent sur le devant de la scène publique les oeuvres d’art. Peu de personnes racisées et/ou étrangères occupent des postes à responsabilité au sein des musées (4).
Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), établi à Winnipeg, a d’ailleurs été dénoncé pour racisme en 2020. En effet, que ce soit en interne – lors du recrutement – ou avec les visiteur·euse·s, les membres du personnel du musée ont souvent eu une attitude discriminatoire envers les personnes noires, autochtones. Celle-ci avait “pourtant” l’objectif de sensibiliser sur les effets de la colonisation (14). Le Musée d’histoire naturelle et des civilisations en Colombie-Britannique a, lui aussi, été accablé par les mêmes faits: discrimination envers les employés autochtones (15). Dès 2021, le directeur général démissionne. Situations encore plus ironiques lorsque l’on parle des musées ethnographiques, ces exemples prouvent un mouvement qui ébranle un système raciste … auquel les musées ne dérogent pas. (15).
Pour rappel: 39 % des dossiers liés à l’emploi ouverts par UNIA concernent des discriminations sur base de critères raciaux, philosophiques ou religieux. (chiffres de 2020).
- Conclusion
Tout cela nous amène à penser et repenser la place de l’art dans nos sociétés, à ne plus la percevoir comme neutre, à lutter pour une meilleure représentation des personnes racisées tant parmi les figures représentées, les artistes, les employés que les directions des institutions muséales… Une étape qui pourrait elle aussi contribuer à la « décolonisation » de nos musées serait la restitution des œuvres. En effet, des musées comme le musée de Tervuren en Belgique ont en leur sein des pièces d’art en partie volées ou rachetées il y a plusieurs années de cela maintenant. Que ce soit pour ce musée, ou d’autres musées occidentaux, les personnes racisées des pays volées réclament la restitution de leurs œuvres (16).
En Europe en particulier, les Africain·e·s se sentent “dépouillés” par les missionnaires et anciens militaires colonisateurs qui ont récoltés tous ces objets et œuvres d’art dans des situations douteuses voire sanglantes (16). Les personnes racisées se sentent donc privées d’une partie de leur histoire, et certain·e·s ont d’ailleurs tenté de reprendre les biens de leurs ancêtres directement dans les musées comme cela a été le cas en France au Musée du Quai Branly (17) .
Sources :
- R. Lachapelle (1981). Mais qu’est-ce donc que les arts visuels? Liaison, (17), 14–16. https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/1981-n17-liaison1165787/43952ac.pdf
- S. Ouanes “Cinq mois après Black Lives Matter, les musées sortent timidement du silence”. Disponible sur https://www.francesoir.fr/, publié le 18 octobre 2020.
- Marie-Laure Allain Bonilla, “ Processus décoloniaux dans l’art : institutions et savoirs “, Critique d’art [En ligne], 52 | Printemps/été, mis en ligne le 27 mai 2020, disponible sur http://journals.openedition.org/critiquedart/46179, consulté le 24 novembre 2021.
- M. Celeux-Lanval “ #BlackLivesMatter : Le monde de l’art à l’épreuve du racisme”. Disponible sur www.beauxarts.com, publié le 18 juin 2020
- DAM, “Pour un processus d’équité culturelle- Rapport de la consultation sur le racisme systémique dans le milieu des arts, de la culture et des médias à Montréal”, disponible sur /www.diversiteartistique.org/, publié en 2018.
- K. Mesbah, “ Secteur culture et artistique belge : quelle place pour les personnes racisées? ” disponible sur www.bepax.or, publié en octobre 2021.
- T. Muteba Luntumbue, “ Secteur culture et artistique belge : quelle place pour les personnes racisées?”,disponible sur www.bepax.or, publié en octobre 2021.
- N. Ver-Ndoye et G. Fauconnier, “Noir entre peinture et histoire”, Ed. Omniscience, 2018.
- Bibliothèque nationale de France, “La figure du Noir dans l’art occidental: représentation, imaginaire et réappropriation”, disponible sur www.bnf.fr, publié en 2019.
- J. Beauzac, “ “Représenter les noir.es : le regard blanc”, disponible sur www.venuslepodcast.com, publié en juin 2020.
- D. Murell, “Seeing Laure: Race and Modernity from Manet’s Olympia to Matisse, Bearden and Beyond”; disponible sur https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8MK69VP, publié en 2014.
- D. E. Pullins, “Review of “Posing Modernity : the black model from Manet and Matisse to today” Wallach Art Gallery, New York and…”, publié en 2018
- Exposition du Musée d’Orsay Paris, “Le modèle noir”, 2019, voir: https://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dorsay-2897/le-modele-noir-72857.html
- T. Jourdan, ” Racisme interne au Musée canadien pour les droits de la personne?” Disponible sur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle, publié le 10 juin 2020.
- M. Trochu,”Racisme et culture toxique au musée royal de colombie britannique “, Disponible sur https://canada-info.ca/, publié le 24 février 2021.
- H. Bellet “ Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre ”, sur Arte.tv : des musées européens peuplés d’œuvres volées”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 28 octobre 2021.
- C. Hertzog “ Tentative de vol au Musée du quai Branly : « Ce que je vous dis vient du peuple africain ”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 30 septembre 2020.
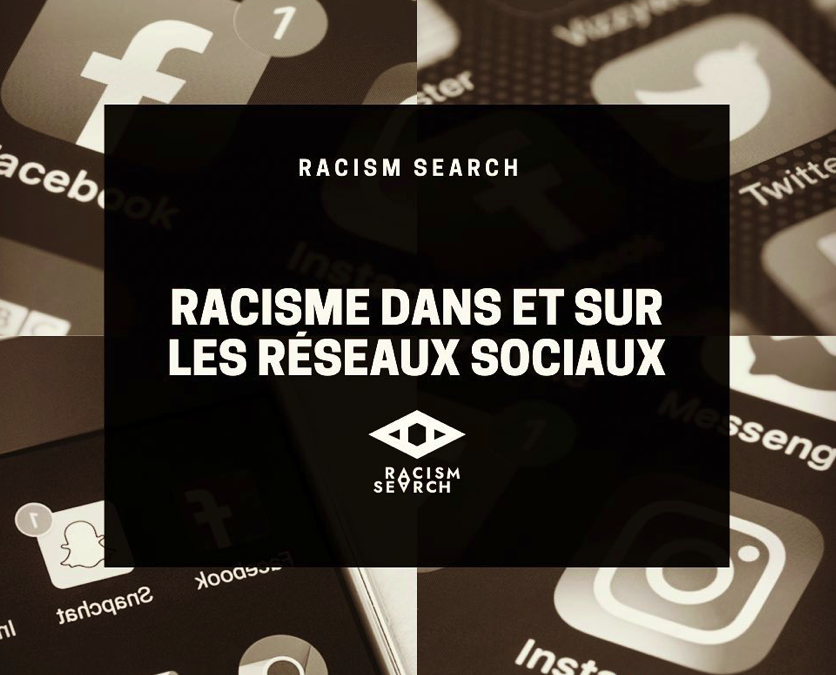
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Discrimination, Général, Racisme
La haine raciale sur les Réseaux Sociaux

Auparavant, les réseaux sociaux n’existaient pas et le racisme n’était visible que dans le “monde réel”, dans la réalité sensible . Or, désormais, en un clic nous disposons de l’information que nous cherchions, nous pouvons communiquer avec des personnes à l’autre bout du monde. Mais loin de n’apporter que des aspects positifs, les réseaux sociaux engendrent des aspects négatifs.
Le déferlement de la haine raciale est l’un d’eux.
En effet, à cause de la popularité des réseaux sociaux, de leur diversité mais aussi de leurs réglementations floues, les discours de haine sont nombreux et se diffusent rapidement sur les différentes plateformes [1]. Alors que des personnes n’oseraient jamais tenir certains propos de visui, Internet devient un défouloir où les langues se délient, de l’#antihomosexuel à #SiMaFilleRamèneUnNoir sous couvert de la “liberté d’expression”[2].
Responsabilité et influence des différentes plateformes
Bien que cela ne soit peut-être pas notre premier réflexe lorsqu’on aborde ce sujet, le racisme sur les réseaux sociaux se manifeste souvent en premier lieu dans la structure et le fonctionnement de la plateforme. En effet, comme le relèvent plusieurs auteurs tels que Marc Faddoul [3] et Sendhil Mullainathan [4], les algorithmes ne sont neutres qu’en apparence.
Ainsi, sur Tik Tok, les recommandations de comptes faites aux utilisateurs se basent sur les caractéristiques physiques des photos de profil des comptes que les utilisateurs suivent déjà. Ce phénomène se nomme “filtrage collaboratif” et peut être problématique car il peut reproduire les préjugés des gens.
“Si la majorité des créateurs populaires sur TikTok sont blancs, par exemple, cela peut empêcher que les créateurs de couleur ayant moins de followers soient vus et recommandés aussi souvent sur la plateforme”[3].
Cela implique également que ces créateurs racisés soient moins rémunérés pour le contenu qu’ils produisent et ne puissent donc pas vivre du fruit de leur travail, et cela non pas à cause de la qualité de leur contenu mais bien à cause des biais des algorithmes.
D’après une enquête du Wall Street Journal [5], les algorithmes employés par Tik Tok recommandent également plus souvent des créateurs correspondant à certains critères de beauté. Si cela est déjà très problématique en soi, les critères sur lesquels se basent ces algorithmes sont des critères de beauté occidentaux, ce qui exclut une fois encore les personnes racisées des recommandations de Tik Tok.
Sendhil Mullainathan, dans un article au New York Times, incite les plateformes à remédier au problème des préjugés algorithmiques, de la manière suivante : en “s’assurer que toutes les données nécessaires à l’algorithme, y compris les données utilisées pour le tester et le créer, sont soigneusement stockées ” [4].
Des contenus à connotation raciste …
En second lieu, le racisme est également présent via le contenu partagé sur les réseaux.
Le cas Tiktok
 Comme mentionné dans le point précédent, la popularité est liée à la question algorithmique. D’ailleurs, un #BlackTikTokStrike a débarqué sur les réseaux pour dénoncer l’appropriation culturelle* des danses issues de la communauté noire. Beaucoup de tiktokeurs et influenceurs blancs reprennent – consciemment ou non – des danses qui deviennent virales, sous leur nom.
Comme mentionné dans le point précédent, la popularité est liée à la question algorithmique. D’ailleurs, un #BlackTikTokStrike a débarqué sur les réseaux pour dénoncer l’appropriation culturelle* des danses issues de la communauté noire. Beaucoup de tiktokeurs et influenceurs blancs reprennent – consciemment ou non – des danses qui deviennent virales, sous leur nom.
Ce qui est décrié est le peu de popularité de ces danses lorsqu’elles sont exécutées par les auteurs noirs qui, par conséquent, ne perçoivent pas les retombées de leur création .. [7]
La plateforme réagit :
“Nous nous soucions profondément de l’expérience des créateurs noirs sur notre plateforme et nous continuons à travailler chaque jour pour créer un environnement de soutien pour notre communauté, tout en instillant une culture où honorer et créditer les créateurs pour leurs contributions créatives est la norme.” [7]
L’ISD (Institute for Strategic Dialogue) s’exprime à travers d’un rapport sorti en août 2021 “TikTok fonctionne comme une nouvelle arène pour les idéologies haineuses incitant à la violence.” [6] Des vidéos qui rient et nient l’Holocauste et l’instrumentalisation d’une chanson juive (Hava Nagila) sont des exemples percutants dénoncés par l’ISD [6]. Ils sont représentatifs d’une transmission de haine raciale.
Sur Instagram, on peut rappeler le challenge lancé par la star de Télé-réalité Jazz qui s’est peint la moitié du visage en noir. Consciente ou non de son acte, elle s’est vite fait lourdement critiquée par les internautes [8]. Cette pratique nommée “BlackFace” est fortement empreinte de connotations racistes**. Avec les médias virulents, ce genre d’accident peut vite être repris par des personnes qui ont peu de recul critique sur lesréseaux sociaux, ou qui sont juste inconscientes de la problématique.
Les commentaires des utilisateurs
Nous en parlions déjà dans notre article sur le racisme en milieu sportif lorsque nous soulignions les commentaires haineux qu’on subit les joueurs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro. Les internautes jouent aussi un grand rôle dans la propagation de la haine raciale sur les réseaux sociaux.
Nous avons déjà tous vu des commentaires racistes sous des articles parlant d’immigration par exemple ou des incitations à la haine raciale sur des réseaux tels que Twitter ou Instagram. Ces commentaires vont même parfois jusqu’à des appels aux meurtres, et bien que l’option “signaler ce commentaire” ou cette publication existe, il est à noter que les géants d’Internet sont généralement peu réactifs [9]. Ces outils de signalement ont été utilisés sur trois grandes plateformes ( Instagram, facebook et youtube) par L’UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie et uniquement 77 contenus ont été supprimés sur les 548 signalés [10].
Equilibre entre la liberté d’expression et le devoir d’action
Si une majorité d’internautes est consciente que de tels propos ont des impacts au-delà des réseaux sociaux, l’absence de conséquences sur la sphère digitale est une raison qui pousse à exprimer ouvertement une intolérance et/ou une haine envers certains groupes de personnes. Ce qu’il reste intéressant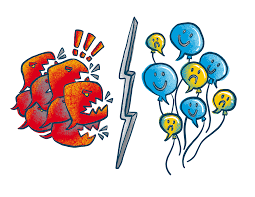 à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit d’exprimer son opinion ou ses idées sans qu’une réprobation ne puisse être prise à l’égard de son auteur et ce, même si ces idées sont inconvenantes, déplacées, et outrageuses [11].
à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit d’exprimer son opinion ou ses idées sans qu’une réprobation ne puisse être prise à l’égard de son auteur et ce, même si ces idées sont inconvenantes, déplacées, et outrageuses [11].
Toutefois, dans ce grand nombre de personnes qui invoquent la liberté d’expression pour vociférer des propos racistes et discriminatoires, peu importe la limite imposée à cette liberté, lorsque ces propos révèlent une incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou à la ségrégation à l’égard d’autrui sur un lieu public* [11].
S’il est possible d’obtenir une condamnation pour ce type de propos en justice, il faut se demander s’il n’y a pas un moyen de prévenir ce type de comportement sur les réseaux sociaux.
*Notons qu’un lieu public désigne également tout message, vidéo ou photo sur internet qui est communiqué ou accessible à une ou plusieurs personnes.
Les plateformes sont les vecteurs principaux de la propagation du racisme. Elles ont une responsabilité à l’égard de la société d’introduire des règles de conduite et des sanctions suffisantes pour dissuader ce genre de commentaires. Cela est notamment appuyé par l’Union européenne qui a imposé une condamnation financière à tout réseau social qui ne respectait pas les réglementations luttant contre le racisme [12].
Au vu de ces règles et notamment de l’intervention de la justice, nous pouvons constater que certaines actions ont été entreprises par les plateformes digitales afin de remédier à ce problème. Ainsi, par exemple, il a été révélé par l’Unia que les plateformes ont employé du personnel chargé de nettoyer les commentaires haineux, dangereux et discriminatoires [12].
Toutefois, l’afflux de haine sur les réseaux ne fait qu’augmenter et certains doutent de la réelle effectivité du plan d’action de ces plateformes. A titre illustratif, le réseau Twitter a récemment été assigné en justice par quatre associations luttant contre des discriminations pour son manque de réelles actions [13]. Ceci n’est qu’un exemple de l’écart entre le devoir d’action des entreprises et la mise en œuvre d’une véritable restriction. Mais expliqué ci-dessus, le même problème est toujours observé sur les autres plateformes populaires sur lesquelles il reste possible de véhiculer des discours racistes sans réelle conséquence.
* N’hésite pas à aller lire l’article sur l’appropriation culturelle pour en savoir d’avantage (12 avril 2021)
** Notre position sur le phénomène “BlackFace” est expliquée dans l’article “Pourquoi le père fouettard est-il problématique?” (6 décembre 2020)
SOURCES :
[1] A. de Latour, N. Perger, R. Salaj, C. Tocchi, P. Viejo Otero, C. Del Felice et M. Ettema, R. Gomes, “Alternatives: Les contre-récits pour combattre le discours de haine ”, Strasbourg, France: Conseil de l'Europe, 2017, p. 45.
[2] G. Peronne, “Discrimination et réseaux sociaux”, disponible sur www.pnrs.ensosp.fr, Décembre 2014.
[3] Forbes, “Tik Tok : la plateforme est-elle raciste?”, disponible sur www.forbes.fr, publié le 15 avril 2020
[4] The New York Times, “Biased algorithms are easier to fix than biased people”, disponible sur www.nytimes.com, publié le 06 décembre 2019.
[5]The Wall Street Journal, “Inside Tik Tok’s algorithm: a WSJ video investigation”, disponible sur www.wsj.com, publié le 21 juillet 2021.
[6] Protestinter, A. Molina, “Tiktok gangrené de contenus racistes, antisémites et islamophobes” disponible www.reformes.ch, publié le 31 août 2021
[7] Courrier International, “ #BlackTikTokStrike, le mouvement de révolte des danseurs noirs”, disponible sur www.courrierinternational.co , publié le20 juillet 2021
[8] G. Dauge, “PHOTO Jazz (JLC Family) accusée de “blackface”, elle supprime son dernier cliché qui fait polémique”, disponible sur www.voici.fr, publié le 1 juin 2021
[9] C. Belaïch , “ Peut-on lutter contre l’incitation à la haine sur les réseaux ”, disponible sur www.liberation.fr, publié le 13 mai 2016.
[10] SOS Racisme, “ SOS Racisme, SOS Homophobie et l’UEJF étrillent Twitter, YouTube et Facebook”, disponible sur www.sos-racisme.org, consulté le 16 octobre 2021.
[11] UNIA, “Les limites à la liberté d’expression”, disponible sur https://www.unia.be, consulté le 15 octobre 2021.
[12] K. Azzouz, “Racisme et réseaux sociaux : l'impunité s'est pris les pieds dans la toile”, disponible sur https://www.rtbf.be/, publié le 19 février 2020.
[13] Martin Untersinger, “ Twitter assigné en justice pour son « inaction massive » face aux messages haineux”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 12 mai 2020.
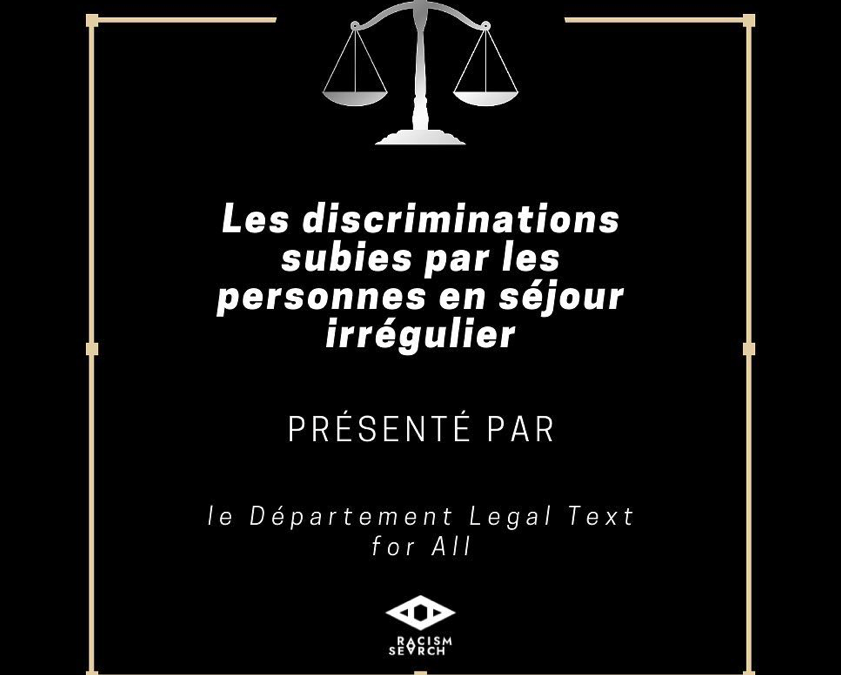
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Discrimination, Legal Text For All

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Débat, Racisme, White privilege
Le White Privilege
“Je suis née blanche comme d’autres sont nés hommes. […] Le privilège, c’est avoir le choix d’y penser, ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme. Mais je peux oublier que je suis blanche. Ça, c’est être blanche. Y penser, ou ne pas y penser, selon l’humeur. »
1. Définition du concept
S’agissant d’un concept faisant beaucoup grincer les dents et étant vivement débattu dans l’espace public, nous jugeons utile d’aborder la problématique du “ white privilege ».
Tout d’abord, il est important d’avoir en tête la définition du mot privilège. Selon le dictionnaire Le Robert, le privilège est un “ droit, avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité, en dehors de la loi commune” [1] .
Ainsi, tout être humain, de manière générale, est soumis à des privilèges qui peuvent être directement liés à son apparence, à son appartenance ethnique ou encore à sa classe sociale.
Quand on parle de privilège blanc, de blanchité, on ne vise donc pas à accuser les personnes blanches d’être blanche, mais plutôt à souligner les privilèges dont elles diposent dans un monde où le racisme systèmique* prévaut [2].
En effet, “ la blanchité permet de tirer avantage involontaire, voire inconsciemment , du fait que d’autres personnes soient racisées donc discriminées” [3].
Enfin, nous pouvons reprendre la définition du “privilège blanc” utilisée par la ligue des droits et liberté qui nous semble assez précise et consise; c’est un ensemble d’ « avantages invisibles mais systématiques dont bénéficient les personnes dites « Blanches » uniquement parce qu’elles sont « Blanches » [3].
* Voir article “ qu’est-ce que le racisme? ” pour les différents types de racisme.
2. Apparition du terme en Amérique
Le terme “white privilege”, traduit en français comme privilège blanc, est apparu aux États-Unis à partir des années 60, par les activistes et universitaires [4]. C’est pourtant Peggy McIntosh, féministe, activiste blanche et auteure en 1989 de l’article “ White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack” *, qui théorise le concept. Elle énumère des exemples concrets de ce que représente le privilège blanc. [4]

Katie Koch, « Using privilege helpfully' », The Harvard Gazette, photographiée par Stephanie Mitchell, publié le 19 décembre 2012, disponible sur https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/12/using-privilege-helpfully/
Mais qui est-elle? Née en 1934, Peggy McIntosh grandit dans une famille aristocratique dans le New Jersey. Elle étudie à Radcliffe et obtient un doctorat d’anglais à Harvard [7]. Son ouvrage reste un appui théorique couramment utilisé en sociologie [8].
Dans son article, on lui reproche pourtant de mélanger dans certains points de sa liste le “privilège blanc” et le privilège de sa classe sociale. [4] Cette critique permet de concevoir la connexion entre ces deux luttes et repenser au concept d’ ”intersectionnalité”, popularisé par la sociologue Patricia Hill Collins, féministe noire [8].
3. Une période tumultueuse
L’émergence du concept et sa revendication apparaît dans une période tumultueuse et représente une nécessité. Les “sixties” représentent une période de changements et de luttes pour les Afro-descendants aux Etats-Unis.
En effet, durant cette décennie, les luttes pour l’égalité entre les “races” ont permis le début d’une “déségrégation” de la vie quotidienne des Noirs américains avec la loi sur les droits civiques de 1964 adoptée par le président Lyndon Johnson qui abolit certaines discriminations liées à la race. [5] Néanmoins, le chemin est long et périlleux; les Noirs continuent à subir des discriminations à l’embauche, à l’accès à l’enseignement, dans les lieux publics *, au droit de vote, etc. [5]
Plusieurs mouvements de luttes pour l’égalité des races émergent. Le mouvement afro-américain des droits civiques (entre 1954-1968) en est un et manifeste contre l’inégalité de traitement entre les ”races”. Martin Luther King -pasteur américain- en est l’emblème et est assassiné en 1968. [6] Cet exemple, parmi d’autre, permet de rendre compte d’une prise de conscience et d’une pensée générale qui a amené à conceptualiser “le privilège blanc”.
Depuis les années 2000, ce terme s’est vulgarisé et s’est installé dans l’espace public [4] Précurseur d’une nouvelle façon d’appréhender le racisme, le concept amène de nombreux débats.
3. Controverse et débat dans l’espace public
La notion de privilège blanc a profondément divisée. Ce terme utilisé pour illustrer l’expérience des personnes racisées et les effets du racisme a été jugé comme une attaque, une arme à l’encontre des personnes blanches.
Tout d’abord, ce terme apparaît, pour certains, comme un outil “contre-productif” en ce qu’il renforce la distinction entre personnes racisées et non racisées. [9] C’est ainsi que nous avons pu apercevoir des réactions vives de haine ou d’incompréhension, criant au “reverse racism” ou à la victimisation des personnes racisées.
Or, le sociologue Eric Fassin, co-auteur de “De la question sociale à la question raciale”, rappelle qu’il ne s’agit pas d’une notion qui entérine les inégalités raciales mais au contraire il s’agit d’un concept qui contribue à mettre en lumière le racisme. Ainsi, selon ce dernier, “il est important de rappeler que les racisés ne sont pas définis par leur couleur de peau, mais par leur expérience similaire du racisme. Quand on est un parent racisé, on ne s’inquiète pas de la même manière quand nos ses enfants rentrent un peu tard le soir. Ça ne veut pas toujours dire qu’on a raison de craindre le racisme, mais la charge réside dans le fait d’avoir à se poser la question. En tant que blanc, si on me refuse un appartement, je ne me dirais pas que c’est pour cette raison. C’est un privilège.” [11]
Ensuite, certains refusent d’accepter ce concept en raison des différences historiques entre les Etats-Unis et les pays européens. Force est néanmoins de reconnaître que le privilège blanc est bel et bien une conséquence des inégalités raciales, et ce peu importe le lieu. Tel que la sociologue française Claire Cosquer l’exprime, “l’existence d’inégalités suppose donc, en toute logique, l’existence de privilèges. Dès lors, dire que le « privilège blanc » n’existe pas en France revient de façon rigoureusement identique à affirmer que le racisme n’existe pas en France”. [10] (Ce même constat peut être appliqué en Belgique).
Sources
[1] Le Robert, dictionnaire en ligne , consulté le 10 juillet 2021, disponible sur www.lerobert.com,
[2] M.Cervulle “la conscience de domination.Rapports sociaux, race et subjectivation”, Cahier du genre, 2012/2, n°53, pp.38-39.
[3] A. Pierre, “ Ligue des droits et libertés, “Mots choisis pour réfléchir au racisme et à l’antiracisme ”, Revue des droits et libertés, automne 2016, disponible sur www.liguedesdroits.ca
[4] L. Quiroz, “Le “privilège blanc” : une notion contre-productive pour combattre le racisme ?”, disponible sur https://www.gaucheanticapitaliste.org, publié le 21 novembre 2017.
[5]V. Laroche-Signorile, “Ségrégation et discrimination aux Etats-Unis dans les années 60”, disponible sur https://www.lefigaro.fr, publié le 20 février 2015.
[6] U. N'Gbatongo, “Les mouvements afro-américains des droits civiques des années 1960”, disponible sur https://les-yeux-du-monde.fr, publié le 27 mai 2018.
[7]W. Ray, “ “Privilège blanc” : ce qui se cache derrière le slogan”, disponible sur https://www.lepoint.fr, publié le 30 septembre 2018.
[8]N. Lisa Cole, “Understanding and defining White privilege”, disponible sur https://www.thoughtco.com, publié le 22 juin 2020.
[9] C. Simon, “Antiracisme : quatre questions à se poser sur le concept de “privilège blanc””, disponible sur https://www.leparisien.fr, publié le 10 juin 2020.
[10] C. Cosquer, “ L’expression de “privilège blanc” n’est pas dénuée de toute pertinence pour penser le contexte français”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 16 juin 2020.
[11] O. Diallo, “ Eric Fassin : “Les racisés ne sont pas définis par leur couleur, mais par leur expérience du racisme”, disponible sur https://information.tv5monde.com, publié le 28 avril 2020.
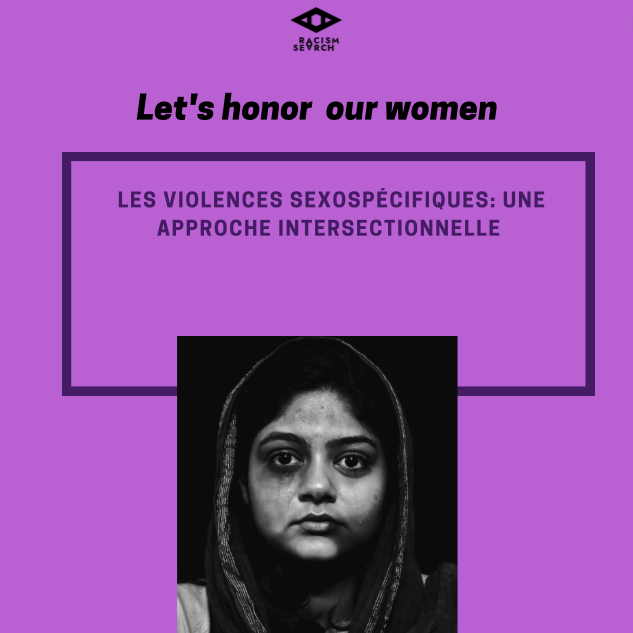

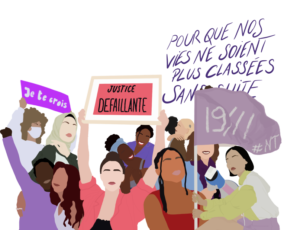


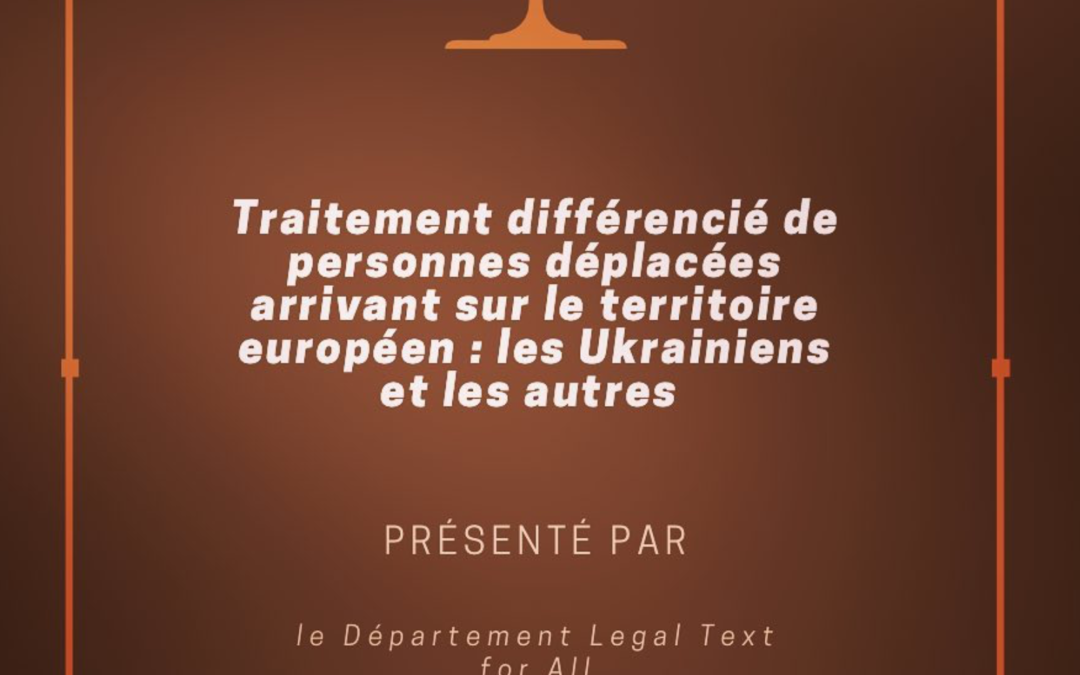

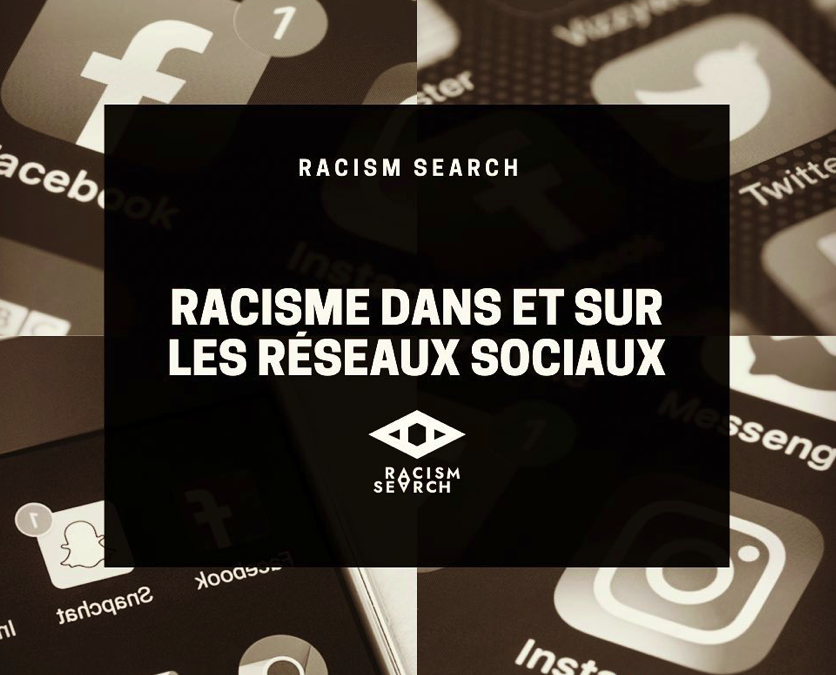

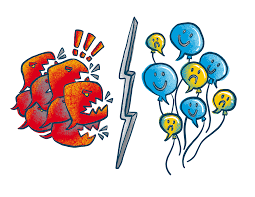 à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit
à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit