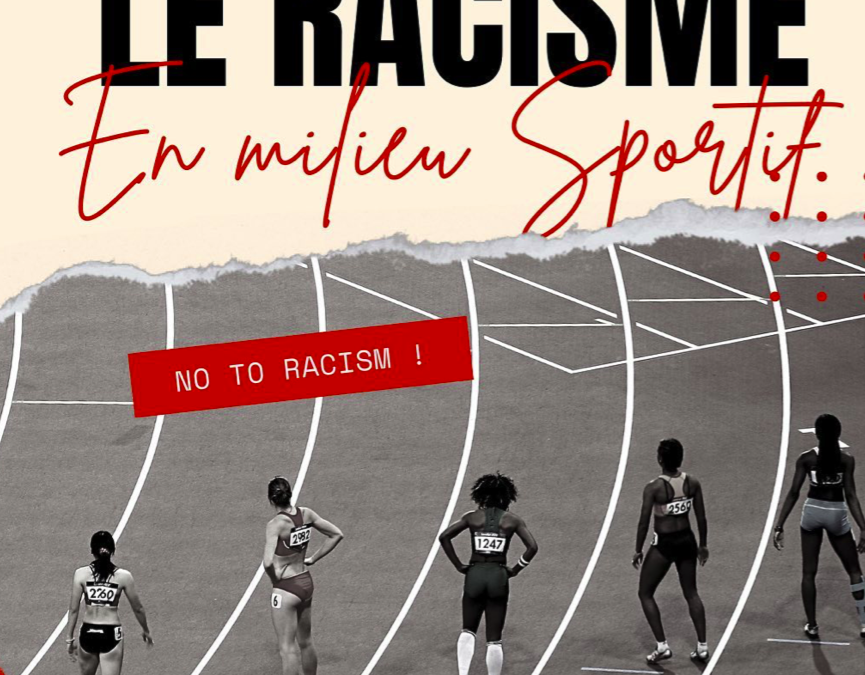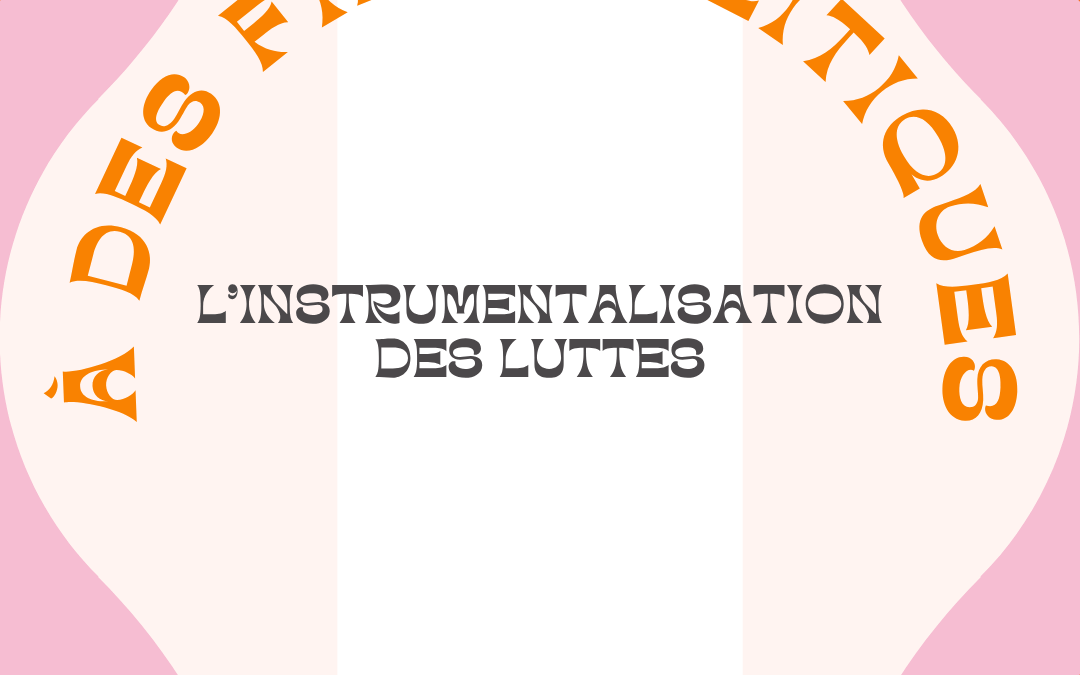
par racism-search | Août 4, 2025 | Discrimination, Général, Intersectionalité, Racisme
L’homonationalisme : Quand les droits LGBTQIA+ participent à l’agenda nationaliste
L’homonationalisme est une notion qui a été formulée pour la première fois par la chercheuse Jasbir Puar dans son ouvrage “Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times”. Par ce terme, l’autrice dénonce
“l’utilisation de l’“acceptation” et de la “tolérance” à l’égard des gays et des lesbiennes comme baromètre permettant d’évaluer la légitimité et la capacité de la souveraineté nationale.” [1]
En l’essence, le terme homonationalisme fait référence à l’inlcusion des droits LGBTQIA+ dans le discours nationaliste en excluant celleux percu·e·s comme “étranger·ère·x·s” [2]. Rédigé en 2007, ce texte se situe dans le contexte post-11 septembre 2001 et de la « guerre contre le terrorisme » proclamée par l’administration Bush, contribuant ainsi à cristalliser le discours du « NOUS » contre les « EUX » [3].
En effet, après les tragiques évènements du 11 septembre, nous avons pu voir prolifiérer une haine contre l’islam et les personnes mulsumanes ainsi qu’une intensification de l’instrumentalisation des corps queer pour renforcer des discours racistes [4]. L’homonationalisme critique précisément les discours libéraux qui présentent les droits LGBT comme un signe de progrès, tout en continuant à accorder ces droits à certains groupes seulement, et en en excluant d’autres [4].
Un concept états-uniens qui dépasse les frontières
Ce constat dépasse les Etats-Unis puisqu’en Europe et plus précisément en Belgique, nous observons également comment les droits des personnes LGBTQIA+* sont parfois instrumentalisés pour servir des discours islamophobes ou racistes. Sous couvert de défendre l’égalité, certaines politiques et prises de position excluent, stigmatisent ou visent directement les personnes racisées, notamment les personnes musulmanes.
 source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken
source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken
Dans un échange douteux datant du 2 mai 2007, Theo Francken analyse pourquoi les homosexuels sont traités de manière plus agressive à Bruxelles. « Cela n’a rien à voir avec nous mais avec le nombre élevé d’islamistes et de petits cons marocains. » Et de terminer en ironisant: « Tous les musulmans en dehors de Bruxelles? Ce serait amusant 😉« .

Ces critiques avaient déjà émergé lors de l’adoption du Plan interfédéral contre les discriminations et les violences à l’égard des personnes LGBTI 2018-2019. Plusieurs acteurs et actrices du monde associatif et académique avaient alors dénoncé une focalisation disproportionnée sur les communautés musulmanes, présentées comme principales responsables de l’homophobie [5]. Iels dénoncent le caractère réducteur de cette approche, qui invisibilise des réalités bien plus complexes. Par exemple, la première personne reconnue par la justice belge comme victime d’un crime homophobe, Ihsane Jarfi, était à la fois racisé et musulman [5]. À l’inverse, trois des quatre auteurs de son meurtre étaient blancs et non-musulmans [5]. Ce cas rappelle que l’homophobie n’est pas propre à une seule communauté, contrairement à certains discours qui cherchent à l’ethniciser ou à la « culturaliser ». D’autant plus que le père d’Ihsane, professeur de religion islamique, a ensuite fondé une organisation engagée activement contre l’homophobie [6].
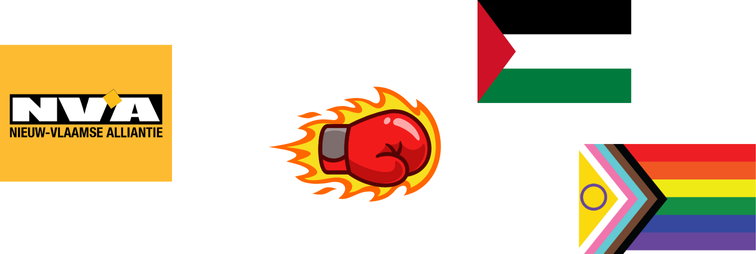
La N-VA a notamment été critiquée par Alexander Dhoest pour son instrumentalisation de la défense des droits LGBTQIA+, mobilisée principalement comme levier politique contre l’Islam et les personnes d’origine étrangère [3]. Ils reprennent ainsi les logiques de l’homonationalisme, en construisant un « nous » LGBT-friendly, perçu comme appartenant au groupe national légitime, en opposition à un « eux » musulman et supposément homophobe [3].
Enfin,lors de la dernière campagne électorale, certains partis ont opposé leur soutien au peuple palestinien à la défense des droits LGBTQIA+, en arguant que ces droits ne seraient pas respectés en Palestine, contrairement à Israël.
Cette rhétorique s’inscrit dans une logique plus large de Pinkwashing**, notamment observée dans la politique israélienne, qui met en avant son prétendu respect des droits LGBTQIA+ comme outil de légitimation de son occupation des territoires palestiniens[7]. Comme le souligne plusieurs travaux critiques, cette stratégie permet à Israël de se présenter comme la seule démocratie « progressiste » du Moyen-Orient, face à des populations palestiniennes décrites comme rétrogrades ou barbares, renforçant ainsi un discours colonial et islamophobe, et invisibilisant les militant·es queer*** palestinien·nes [7]
* Cet acronyme désigné les personnes Lesbiennes, Gay, Bi, Transgenres, Queer (désigne également parfois les personnes en Questionnement), Intersexes, Asexuelles/Aromantiques.
*Le pinkwashing désigne le fait pour un gouvernement, une entreprise ou une organisation de mettre en avant un soutien apparent aux droits LGBTQ+ pour améliorer son image ou détourner l’attention d’autres actions controversées.
**Le mot « queer » veut dire “bizarre”. Originairement une insulte, le terme a été réapproprié et désigne aujourd’hui une identité ou une façon de se situer en dehors des normes traditionnelles liées au genre et à la sexualité.
Le fémonationalisme : La manipulation des droits des femmes
Le terme fémonationalisme, forgé par Sara Farris, s’inspire en partie de la notion d’homonationalisme. Il désigne :
« la mobilisation contemporaine des idées féministes par les partis nationalistes et les gouvernements néolibéraux sous la bannière de la guerre contre le patriarcat supposé de l’Islam en particulier, et des migrants du Tiers monde en général. » [8].
Cette logique n’est pas nouvelle : dans les années 1970 déjà, il ne s’agissait pas de « sauver » les femmes musulmanes, mais les femmes de l’Est, perçues comme opprimées par des hommes violents et barbares [8].Dans cette perspective, la femme blanche occidentale reste la norme émancipée, tandis que la femme racisée, perçue comme extérieure à cette norme, est réduite au rôle de victime passive de son patriarcat [9].
Comme le résume si bien Gayatri Spivak :
“white men saving brown women from brown men.”
(Can the Subaltern Speak?)
Cette rhétorique s’inscrit dans une longue histoire de discours colonialistes et impérialistes, qui s’appuyait déjà sur des arguments similaires et qui est parfois portée par des migrant·es elleux-même, renforçant l’image du “Bon migrant” contraire au “ mauvais migrant” [9].
Termes différents mais même schéma et objectif
Que l’on parle d’homonationalisme ou de fémonationalisme, on assiste à une récupération et une instrumentalisation de luttes légitimes (contre le sexisme ou pour les droits LGBTQIA+) au service d’agendas souvent islamophobes. Ces dynamiques ont des conséquences concrètes. En valorisant une queerness exclusivement blanche, laïque et non-musulmane, ces discours invisibilisent les identités à l’intersection – celles qui ne rentrent pas dans ce cadre normatif, et qui subissent ainsi une double marginalisation.
Enfin,ce type de discours, souvent mobilisé pour « sauver » les personnes perçues comme arabes et queer, s’inscrit dans une logique orientalisante (au sens d’Edward Said) qui impose une vision occidentale normative des droits LGBTQIA+ et promeut un discours qui prétend défendre les personnes queer arabes de leurs pays traditionalistes [10].
Conséquences concrètes sur les personnes concernées
Les discours homonationalistes et fémonationalistes ne sont pas de simples effets de langage : ils produisent, maintiennent et justifient des rapports de pouvoir qui affectent très concrètement la vie des personnes queer racisées.
Ces logiques articulent le racisme, la queerphobie, l’islamophobie, le classisme, et parfois même la misogynie, dans un enchevêtrement de violences structurelles, souvent déguisées en “protection”. Loin de garantir sécurité ou inclusion, elles placent les personnes concernées dans une double impasse : ni pleinement reconnues dans les espaces queers majoritaires, ni protégées dans les institutions dominantes, elles deviennent à la fois survisibles et exclues, assignées et effacées.
- Surveillance accrue, fausse promesse de protection
Quand des partis d’extrême droite prétendent défendre les “droits des femmes” ou des “personnes LGBTQIA+” pour justifier des politiques racistes ou islamophobes, iels ne protègent pas les personnes queer racisées : iels les utilisent comme prétexte à la répression d’autres groupes ciblés. Cela installe un climat dans lequel la personne queer racisée est l’objet d’un soupçon permanent : soupçonnée d’être “traîtresse” si elle refuse de se faire l’alliée du nationalisme queer-blanc, et soupçonnée d’être “problématique” dans les milieux militants si elle exprime des critiques sur le racisme interne. Cette position instable produit une fatigue politique constante, une hypervigilance émotionnelle et une impossibilité à se situer en sécurité dans les espaces.
Comme le dit M. (extrait du mémoire de S. Sarac) : « Mon identité n’est pas plus protégée demain quand on aura quelqu’un de gay à la tête du Vlaams Belang. »
Autrement dit, la récupération d’une identité ne crée aucun filet de sécurité, tant que les structures de pouvoir restent inchangées. Elle ne fait que valider un récit où certaines formes d’identité queer (blanche, “out”, assimilable, apolitique) sont valorisées, et d’autres invisibilisées, voire criminalisées. [11].
- Espaces LGBTQIA+ majoritaires : entre exclusion feutrée, instrumentalisation politique et insécurité pour les personnes queer racisées
Les personnes queer racisées se heurtent à des espaces LGBTQIA+ où l’inclusion est souvent conditionnelle, superficielle ou performative. Ces milieux, qu’ils soient institutionnels, militants ou festifs, restent largement façonnés par des normes blanches, bourgeoises, laïques, cisnormatives et occidentales. Cela produit une violence insidieuse : celle de devoir sans cesse négocier sa place, de jouer un rôle, ou de disparaître pour ne pas déranger.
Comme le dit Farzana :
“C’est un cercle très blanc. […] En fait les, les la manière de penser l’identité LGBT mainstream est très fort sur le coming out, le fait de couper ta famille. […] En mode « si tu prends tous ces step là bah tu seras comme nous », on sera jamais comme eux..”.”
Dans ces espaces, l’exclusion prend des formes feutrées mais constantes : blagues racistes ou orientalistes, méconnaissance des codes culturels non-blancs, méfiance envers les vécus religieux, silenciation des formes d’expression politiques non calibrées. Cette violence symbolique s’ajoute à des conditions d’accès concrètement inégalitaires : lieux géographiquement ou économiquement inaccessibles, événements sans traduction ni médiation culturelle, absence de représentation réelle dans les décisions.
Mais ce rejet ne s’accompagne pas d’indifférence : au contraire, les personnes queer racisées sont souvent hypervisibilisées de manière utilitaire. Leur présence est attendue pour “diversifier” une affiche, “donner un témoignage fort”, “apporter un regard intersectionnel”. Cette tokenisation produit une inclusion sous contrôle : elles sont conviées, mais rarement écoutées ; valorisées, mais pas protégées ; montrées, mais peu considérées comme actrices politiques.
On attend d’elles qu’elles incarnent la “diversité inclusive”, mais pas qu’elles déstabilisent la structure.
Dans ces conditions, les espaces censés être refuges peuvent devenir des lieux de danger symbolique et politique. La promesse d’un “safe space” se retourne contre les plus marginalisé·es, qui y vivent de l’épuisement, du gaslighting militant, ou un isolement profond. Beaucoup choisissent alors de se replier, ou de construire leurs propres espaces, souvent précaires, invisibilisés, ou privés de ressources. [12]
3. Colonisation des espaces queers par l’extrême droite
Depuis les années 2000, on observe une dynamique où des institutions étatiques ou des acteurs nationalistes s’approprient les luttes LGBTQIA+ pour en faire un outil de domination. Il ne s’agit plus simplement de récupérer des symboles queer : ces discours sont détournés pour renforcer des frontières raciales, migratoires et culturelles, excluant les personnes queer racisées tout en renforçant l’autorité des États ou des partis réactionnaires. C’est ce que l’on peut nommer une colonisation idéologique des espaces queers, un processus où les luttes LGBTQIA+ sont vidées de leur substance politique pour être instrumentalisées au service d’un projet autoritaire et raciste.
Un exemple emblématique est celui des Pays-Bas. Dès 2006, le gouvernement a introduit une vidéo imposée à toute personne migrante, censée refléter les « valeurs néerlandaises » : on y voyait des couples gays s’embrasser et des femmes seins nus sortant de l’eau. Ce dispositif visait spécifiquement les personnes musulmanes, à qui il était implicitement demandé de renoncer à leur projet migratoire si ces images les heurtaient. Plus tard, une politique d’« homo-émancipation » fut lancée, mais elle ciblait prioritairement les communautés marocaines et turques comme supposées « problématiques », tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés. L’homophobie n’y était pas combattue en tant que phénomène structurel, mais utilisée comme prétexte pour marginaliser des groupes racisés et renforcer une identité nationale exclusive. Cette logique transforme les droits LGBTQIA+ en outil de hiérarchisation raciale qui associe modernité et droits des personnnes queer d’un côté, islam et homophobie de l’autre, tout en ignorant les luttes queer déjà existantes dans ces communautés.[13]
Ce type de stratégie est désormais déployé ailleurs en Europe. En France comme en Belgique, des groupes comme Éros ou Némésis, aux discours masculinistes, transphobes et identitaires, tentent de s’imposer dans les marches des fiertés. Présents à Paris et Bruxelles, ils se réclament de la “défense des vrais gays blancs” et accusent les musulmans d’importer l’homophobie; fracturant ainsi les communautés LGBTQIA+ entre “bons sujets” (blancs, intégrés, nationalistes) et “mauvais sujets” (racisé·es, musulman·es, trans, critiques du système).[14] Pride Paris 2025, collectif Eros
On peut également citer le cas d’Alice Weidel, cheffe de file du parti néonationaliste AfD en Allemagne [15] , incarne à lui seul ce brouillage idéologique. Lesbienne, vivant en Suisse avec une compagne d’origine sri-lankaise et mère de deux enfants issus de l’adoption internationale, elle est pourtant l’une des voix les plus dures contre l’immigration, les personnes musulmanes et les droits des minorités. Son profil “inattendu” est utilisé pour déminer les accusations de racisme et d’homophobie adressées à son parti. Elle incarne une figure de “minoritaire intégrée”, mobilisée pour légitimer un projet d’exclusion massive, appelant ouvertement à des politiques de remigration et flirtant avec le révisionnisme historique.
Ces offensives montrent que les espaces queers ne sont pas automatiquement progressistes. Sans vigilance politique, ils peuvent devenir le terrain de jeu de récits réactionnaires, qui exploitent les blessures communautaires (racisme intra-LGBTQIA+, transphobie, classisme) pour affaiblir les solidarités. Résister à cette colonisation implique de repolitiser nos espaces et de défendre des fiertés radicales, inclusives, antiracistes et antifascistes.
SOURCES
[1] Jasbir K. Puar, “ Homonationalism As Assemblage:Viral Travels, Affective Sexualities”, JGLR, Vol 4 (2), 2 novembre 2013, p.24.
[2] Alexander Dhoest, “LGBTs In, Muslims Out: Homonationalist Discourses and Counterdiscourses in the Flemish Press”, international journal of communication, n° 14, 2020, p.157.
[3] ibid, pp.158-160.
[4] Jasbir K. Puar, op.cit, p.25-27.
[5] X, “ un plan fédéral LGBTQI : pour qui et pour quoi?”,disponible sur https://www.rtbf.be/article/un-plan-d-action-interfederal-lgbti-pour-qui-et-pour-quoi-9921631, publié le 19 mai 2018.
[6] Sera Sarac, Les personnes racisées présentées comme des personnes queerphobes, une (dé)racialisation de la queerphobie : Comment expliquer la tendance en Belgique à attribuer la queerphobie aux personnes racisées ?, 2022, p.11 (mémoire de maîtrise,université libre de bruxelles).
[7] July Robert & Marie Charue, “Israël: le pinkwashing comme arme coloniale en Palestine”, disponible sur https://www.agirparlaculture.be/israel-le-pinkwashing-comme-arme-coloniale-en-palestine/, publié le 19 septembre 2024.
[8] Sarah Farris, “Les fondements politico-économiques du fémonationalisme”, disponible sur https://www.contretemps.eu/les-fondements-politico-economiques-du-femonationalisme/,publié le 17 juillet 2013.
[9] Ladan Rahbari, “ When gender turns right: racializing Islam and femonationalism in online political discourses in Belgium”, Contemporary Politics, 27 (1), 2020, pp.52-53.
[10] Sera Sarac, op.cit, p. 8.
[11] Idem, p. 139
[12] Idem, p. 52-55.
[13 ] Sandeep Bakshi, “Citoyenneté queer : Inclusion et contestation.”, Les frontières de la citoyenneté, Pélabay Janie, Tarragoni Federico, Boussahba-Bravard Myriam, Sénac Réjane. Presses Universitaires de Rennes, 2024, pp.85-94
[14] Solène Cordier, Un collectif d’extrême droite à la Marche des fiertés parisienne, Le Monde, 28 juin 2025, disponible sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/06/28/un-collectif-d-extreme-droite-a-la-marche-des-fiertes-parisienne_6616239_3224.html
[15] RTBF, Homosexuelle, avec une partenaire d’origine sri-lankaise, Alice Weidel, un profil atypique de l’extrême droite allemande, RTBF, 12 janv. 2025, disponible sur : https://www.rtbf.be/article/homosexuelle-avec-une-partenaire-d-origine-sri-lankaise-alice-weidel-un-profil-atypique-de-l-extreme-droite-allemande-11488235
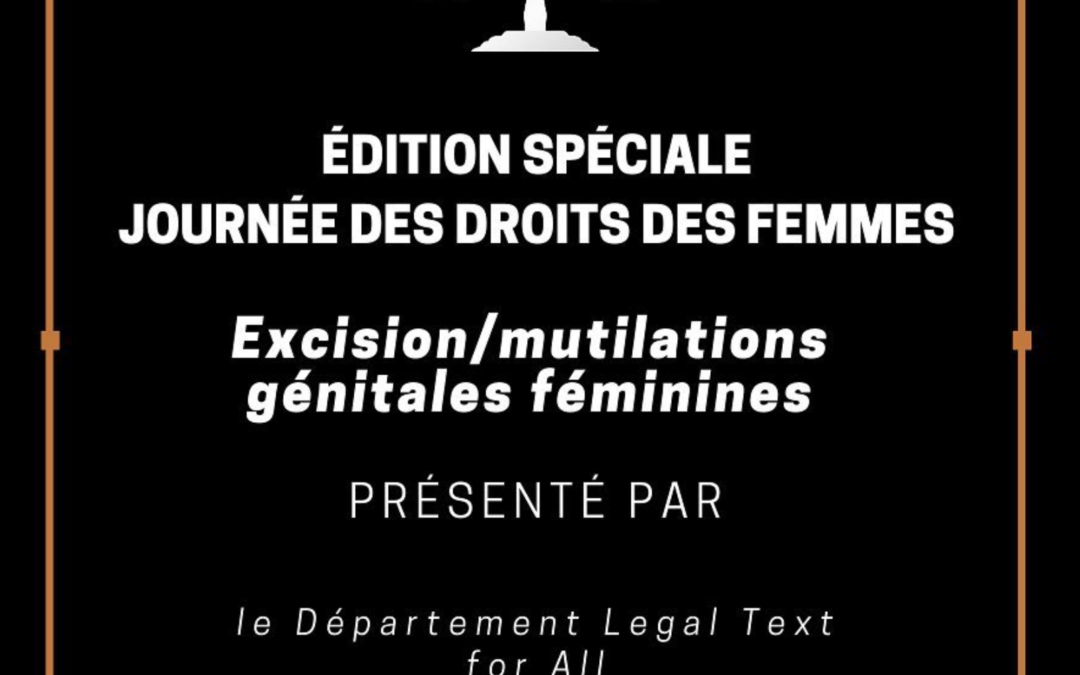
par sandrakabandana | Mar 31, 2024 | Articles, Belgique, Débat, Droits, Général, Intersectionalité
Excisions – mutilations génitales féminines

Sudinfo, « Un clitoris géant en prélude à la journée contre les mutilations génitales », 04 février 2022, www.sudinfo.be
En cette journée internationale des droits des femmes, nous avons fait le choix de nous pencher plus amplement sur la question des mutilations génitales féminines (« MGF« ).
Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi une mutilation génitale. Des dizaines de millions de filles courent encore le risque d’être mutilées d’ici à 2030.
Touche principalement les mineures, sans consentement, parfois sans anesthésie, avec matériel parfois très primaire.
Les pratiques d’excision ont lieu le plus souvent dans l’Ouest, l’Est et le Nord-Est de l’Afrique, dans certains pays d’Asie et au Moyen-Orient, ainsi que dans certaines communautés d’immigrants en Amérique du Nord et en Europe..
D’après l’OMS, plus de 200 millions de femmes et jeunes filles sont concernées par ce problème.
1. Définition
L’OMS définit en 2020 les mutilations génitales féminines comme : « toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales ».
4 catégories :
– Type I : ablation partielle ou totale du clitoris
– Type II : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres
– Type III : infibulation (qui consiste en le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation)
– Type IV : accolement des petites lèvres et/ou des grandes
a. Dispositions internationales ?
Les MGF constituent une violation de plusieurs droits fondamentaux comme le droit à la vie, ou le droit à la santé.
b. Poursuite en Belgique ?
Principe de l’extraterritorialité : toute personne qui a participé, favorisé ou facilité une mutilation y compris à l’étranger, sur une mineure, peut être poursuivie en Belgique à condition que l’auteur se trouve sur le territoire du Royaume
A noter que certaines MGF sont pratiquées également sur le territoire de la Belgique.
c. Dispositions légales belges ?
- Article 409 du Code pénal : une peine de 3 à 5 ans de prison pour « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, ou tenté de le faire, avec ou sans consentement de celle-ci. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. (… )».
2. Droit d’asile en Belgique
Depuis 2006, suite à la transposition de la directive européenne « qualification-asile », on prend en compte les persécutions et les violences (y compris les MGF) infligées en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle comme un élément ouvrant le droit à la protection internationale prévue par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
⇒ L’invocation d’un risque de MGF permet d’ouvrir un droit au statut de réfugié en Belgique. Néanmoins, en 2019, la vision de la Convention de Genève devient plus stricte : seule la personne qui court réellement un risque de MGF a droit à la protection internationale. Le statut de réfugié n’est alors plus ouvert qu’aux enfants. Pour le parent, il pourra demander une autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui régit la procédure de régularisation.
Le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et apatrides) a introduit une procédure de suivi : il exige chaque année une attestation d’intégrité de l’appareil génital de la ou des fillettes concernées. Par exemple, les parents peuvent perdre leur statut de réfugié accordé à l’enfant et à eux-mêmes.
Cependant, cette exigence de suivi de la part du CGRA entraine une difficulté de vérification des sources en vue d’établir la crédibilité de la femme. Une simple erreur peut définitivement compromettre un dossier même si la crainte de persécution est fondée. Ce contrôle met la femme dans une impasse, la considérant toujours suspecte et la contraignant à prouver sa bonne foi. Cela constitue en outre une atteinte injustifiée au droit à la vie privée.
Il existe dès lors également un amalgame entre prévention et répression de l’excision : cette exigence de vérité poursuit les réfugiés reconnus bien au-delà de la demande de protection internationale initiale. La politique d’asile est alors liée à la politique criminelle et il persiste un réel risque de renvoyer les parents dans leur pays d’origine
La Belgique fait partie de l’un des cinq pays les plus demandés concernant la demande de droit d’asile sur le fondement de la pratique des mutilations génitales dans le pays d’origine, fait assez remarquable.
Tout de même, les poursuites pénales sont minimes. Entre 2001 et 2009, l’article 409 du Code pénal n’a jamais été utilisé. Cela est notamment dû à deux éléments:
- l’absence de dénonciation (les filles victimes sont souvent réticentes à dénoncer leurs parents ou leur exciseuse au vu de l’impact qu’une condamnation ou expulsion peut avoir sur la cellule familiale)
- l’absence de signalement de la part des professionnels (dû notamment à un manque de sensibilisation, de preuves et à un malaise concernant ces sujets sensibles).
Notons qu’une reconstruction du clitoris peut être remboursée par l’Inami. Deux centres en Belgique permettent ce type d’opération. Ils se trouvent à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et à l’hôpital universitaire de Gand.
Et vous, que pensez-vous du combat mené contre l’excision en Belgique ? Faudrait-il aller plus loin?
SOURCES
Avalos de Viron Samantha et Grinberg Maia, « Le principe de l’unité de la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA », ADDE, n°155, juillet 2019.
Dieleman Myriam, « Protéger et réprimer : l’excision en Belgique. Genèse et enjeux des dispositions relatives aux mutilations génitales féminines », Migrations Société, 2013/2 (N° 146), p. 57.
Lemercier Elise, « Heurs et malheurs de la lutte contre une pratique sexiste racisée
Regards de médiatrices interculturelles ”africaines” mobilisées contre l’excision», Nouvelles pratiques sociales, 23 mars 2015.
Excsision parlons-en, « Les chiffres de l’excision – Belgique ».
Gams, « Avez-vous vu notre clitoris géant? », 9 février 2022
POUR ALLER PLUS LOIN
Association GAMS
Lecture : Waris Dirie – Fleur du désert
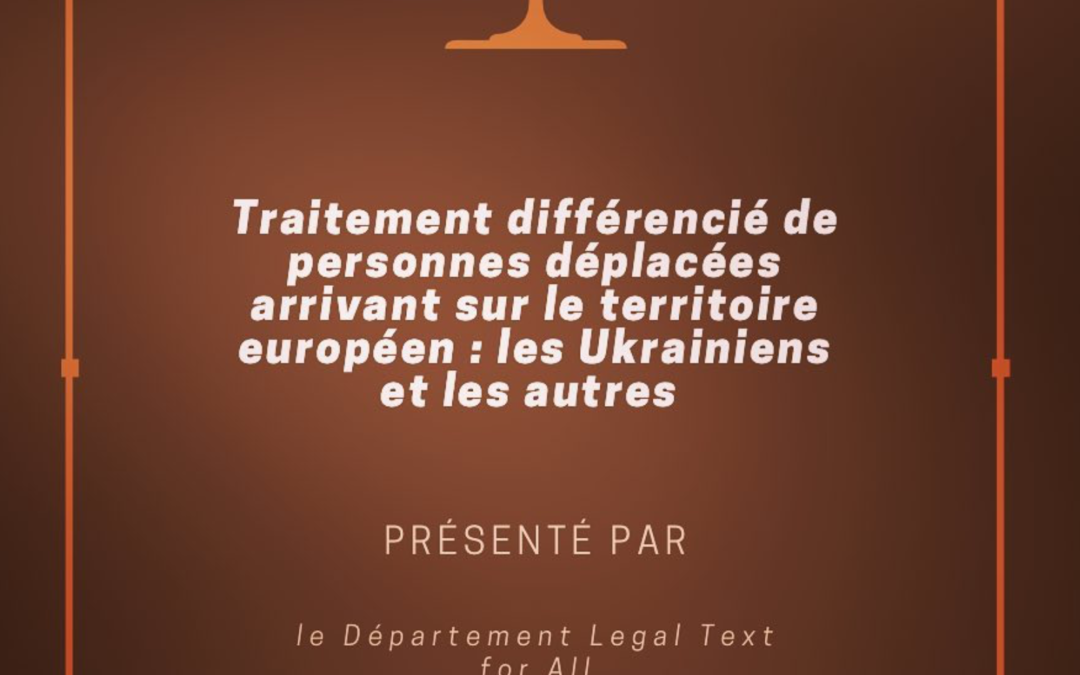
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Débat, Droits, Général, Legal Text For All

par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Débat, Général, Sous représentation
Le milieu de l’art visuel est-il toujours raciste?
Au début du mois, le département content s’est rendu au Musée de l’Afrique Centrale de Tervuren. De cette visite sont nés plusieurs questionnements sur l’art de manière générale: le milieu de l’art visuel est-il toujours raciste ? Et, sur quel maillon de la chaîne, se trouve la discrimination ?
Dans cet article, une attention particulière sera accordée au milieu de l’art visuel. Pour ce faire, définissons d’abord ce que sont les “arts visuels” : il s’agit traditionnellement de la peinture, de la sculpture, du dessin, la photographie mais également le montage vidéo, etc. (1) L’usage du terme “arts plastiques” a été délaissé car il restreint le champ de l’article aux “beaux-arts” et évince dès lors de nouvelles formes d’expressions modernes et contemporaines émergentes.
Bien souvent considérés comme impartiaux, les musées, les galeries ou de tout autre lieu d’exposition rassemblent dans leurs institutions des expressions artistiques. L’ICOM, le Conseil International des Musées créé en 1946 et qui rassemble pas moins d’une centaine de pays, a affirmé en juin 2020 que le musée n’était pas neutre (2). Il s’agit d’une avancée majeure puisque cette même instance a émis une définition du musée reprise par les professionnel·le·s du milieu et a affirmé le rôle de l’institution muséale au sein de la société. Le choix des œuvres, les artistes présentés, les médiateur·ice·s culturels employé·e·s, les membres du personnel… présentent – par leur existence – nécessairement un biais, puisque tout choix amène la renonciation à un autre. L’art au sein des musées, ayant longtemps été vecteur d’une pensée élitiste, a souvent exclu les “subjectivités et les corps non blancs” (3). L’ICOM affirme d’ailleurs que les musées « ont la responsabilité et le devoir de lutter contre l’injustice raciale (…), depuis les histoires qu’ils racontent jusqu’à la diversité de leur personnel » (2).
* Il ne s’agit pas ici de définir ou de limiter à une définition unique ce qu’est une œuvre d’art.
Néanmoins, la réelle déconstruction des personnes chargées de mener à bien la tâche de “décoloniser les arts”** pose question lorsque l’on sait que l’histoire de l’art – toujours étudiée- est plus une « cartographie temporelle périodisée des artistes et des œuvres en Europe de l’Ouest » (3).
« Qu’est-ce qu’un musée décolonial ? Sachant que l’idée même du musée est occidentale. Quelles collections, quels objets, quel mode d’exposition ? La tâche est immense, mais féconde » (4).
Cet article tentera de comprendre les différents rouages sur lesquels travailler la décolonisation de l’art pourrait être intéressant : l’artiste, l’œuvre, les employés du musée. Pour finir, la restitution des œuvres coloniales semble constituer une question inévitable et nécessaire.
- La Sous-représentation des artistes racisés
Comme évoqué dans l’introduction le monde de l’art visible, comme le monde du cinéma ou de la télévision**, est dominé par les personnes blanches. Cette majorité blanche entraîne une vision du monde selon le prisme d’un groupe ethnique privilégié et catégorise les autres types d’art comme “ autres” voire “exotiques” (5). Cela accentue donc le sentiment d’exclusion et d’invisibilité que ressentent les artistes racisés.
Les musées qui ont comme but principal de raconter une histoire, de véhiculer un certain message, doivent émettre des choix précis. Cette sous-représentation d’artistes racisé·e·s insinue une certaine manière de pensée et attire donc un certain type de public, en en excluant un autre (6). Le Conseil des arts du Canada affirmait d’ailleurs déjà en 2015 que la répartition inégale qu’il existe dans le milieu de l’art est « souvent le résultat de réalités historiques rattachées à la conquête, à la colonisation, à la domination culturelle et à l’exclusion systémique » (5).
Le même constat est à faire en Europe, on remarque d’ailleurs qu’il y a très peu de personnes racisées dans les écoles d’art (4). Pourquoi ? S’agit -il d’un désintérêt de ces communautés ? Les filières d’histoire de l’art, sont surreprésentés et enseignées majoritairement par des personnes blanches, masculines et bourgeoises qui adoptent une vision blanche et hétérocentrée de notre société (6). Pour ces raisons, peu de personnes racisées choisissent d’entreprendre ces études, ou si elles le font, plusieurs arrêtent durant leur parcours scolaire.
** Voir notre article “ La sous représentation – manque de diversité “ du 13 décembre 2020.
S’ajoute à cela l’accès au marché de l’art et la visibilité accordée aux personnes racisées. Nous le savons, notre société fonctionne sur un système financier et capitaliste. Dès lors, la question de l’argent est déterminante tant pour les musées que pour les artistes. Or, le budget donné aux artistes racisées et les moyens mis à leur disposition pour visibiliser leur art sont minimes comparés à ceux accordés aux artistes blancs (6).
Comme le relève Toma Muteba Luntumbue, artiste plasticien, commissaire d’exposition indépendant et professeur d’histoire de l’art : avoir une place dans un musée ne suffit pas. Ayant collaboré avec le AfricaMuseum ou le Musée Royal des Beaux-Arts, Monsieur Muteba Luntumbue conclut que ces collaborations finissent toujours ”à votre subalternalisation, sur le plan intellectuel comme sur le plan matériel. Soit parce qu’une catégorie est créée spécialement pour vous y accueillir, soit pour vous marginaliser, on vous rétribue mal ou on ne vous rétribue pas du tout.” (7) Ce n’est finalement qu’en lançant leur propre exposition que les personnes racisées peuvent s’assurer d’être réellement rétribuées et de sortir du rapport colonial qui existe avec les institutions muséales occidentales (7).
Depuis plusieurs années maintenant, des artistes, tel que Jean-François Boclé (d’origine martiniquaise), utilisent leur art pour faire passer des messages politiques et dénoncer le racisme systémique que subissent les personnes racisées dans les anciens pays colonisateurs (4). En faisant part de leur réalité, ils permettent au public d’ouvrir les yeux sur des choses qui, de prime abord, ne les auraient pas marqué. Une véritable diversité des artistes est donc nécessaire pour une représentation réelle de la société moderne.
-
La représentation des personnes racisées dans l’art visuel blanc européen:
Si donc l’histoire de l’art se concentre et valorise les œuvres produites par des blancs, pour des blancs dans un contexte européen, qu’en est-il cependant de la représentation des personnes racisées dans ce type d’art?
C’est en tout cas cette question de départ, qui a fait entreprendre à Naïl Ver-Ndoye et Grégoire Fauconnier leur étude, Noir : entre peinture et histoire (8), où ils étudient plus de 350 oeuvres qui représentent des personnes noires, mais il en existe des milliers rien que dans les collections françaises. Ces oeuvres traversent d’ailleurs toutes les époques puisque l’on retrouve des oeuvres représentant des personnes noires de l’Antiquité à nos jours (9), et des personnes noires de toutes classes sociales (Chevalier Saint-Maurice, Jean-Baptiste Belley…) même si la majorité reste des personnes de classe socio-économique plutôt pauvre (9).
Sans pouvoir revenir sur toutes les analyses qu’ils font dans leur livre, ni de celles formulées dans l’épisode “Représenter les noir.es : le regard blanc” du podcast Vénus s’épilait-elle la chatte (10), plusieurs points d’attention peuvent être soulevés. ![]()
![]()
- La majorité des personnes représentées sur les tableaux sont anonymes. C’est-à-dire qu’on ne sait pas qui elles sont, et que le travail fourni pour trouver ces informations a été insuffisant, voire inexistant. C’est particulièrement marquant lorsque l’on sait que l’identité de la majorité des personnages blancs, même secondaires, est connue. Un exemple frappant, est celui de l’oeuvre Olympia de Manet, peinte en 1863, où figurent une femme blanche et une femme noire l’une à côté de l’autre et seule la femme blanche a fait l’objet d’analyses, de commentaires et de recherches. Ce n’est que très récemment que l’on a pu identifier Laure, la servante noire représentée sur le tableau et en savoir plus sur sa vie (11) .
- Les personnes noires sont rarement le sujet du tableau et occupent généralement le second plan (10). Plus encore, ces personnes ne sont pas toujours représentées pour elles-même mais parfois comme allégories ou symboles.
![]()
![]()
Il faut souligner le travail récent de certains musées, chercheurs et chercheuses qui ont voulu mettre en lumière les personnes noires représentées dans la peinture (12;13), sans que ce travail ne soit pour autant suffisant que pour parvenir à une véritable décolonisation de nos expositions, institutions muséales et vision de l’art dans son ensemble.
- L’absence de travailleurs racisés au sein des institutions culturelles
Si l’on sait que le milieu de l’art est majoritairement blanc, il faut se questionner sur les personnes qui mettent sur le devant de la scène publique les oeuvres d’art. Peu de personnes racisées et/ou étrangères occupent des postes à responsabilité au sein des musées (4).
Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), établi à Winnipeg, a d’ailleurs été dénoncé pour racisme en 2020. En effet, que ce soit en interne – lors du recrutement – ou avec les visiteur·euse·s, les membres du personnel du musée ont souvent eu une attitude discriminatoire envers les personnes noires, autochtones. Celle-ci avait “pourtant” l’objectif de sensibiliser sur les effets de la colonisation (14). Le Musée d’histoire naturelle et des civilisations en Colombie-Britannique a, lui aussi, été accablé par les mêmes faits: discrimination envers les employés autochtones (15). Dès 2021, le directeur général démissionne. Situations encore plus ironiques lorsque l’on parle des musées ethnographiques, ces exemples prouvent un mouvement qui ébranle un système raciste … auquel les musées ne dérogent pas. (15).
Pour rappel: 39 % des dossiers liés à l’emploi ouverts par UNIA concernent des discriminations sur base de critères raciaux, philosophiques ou religieux. (chiffres de 2020).
- Conclusion
Tout cela nous amène à penser et repenser la place de l’art dans nos sociétés, à ne plus la percevoir comme neutre, à lutter pour une meilleure représentation des personnes racisées tant parmi les figures représentées, les artistes, les employés que les directions des institutions muséales… Une étape qui pourrait elle aussi contribuer à la « décolonisation » de nos musées serait la restitution des œuvres. En effet, des musées comme le musée de Tervuren en Belgique ont en leur sein des pièces d’art en partie volées ou rachetées il y a plusieurs années de cela maintenant. Que ce soit pour ce musée, ou d’autres musées occidentaux, les personnes racisées des pays volées réclament la restitution de leurs œuvres (16).
En Europe en particulier, les Africain·e·s se sentent “dépouillés” par les missionnaires et anciens militaires colonisateurs qui ont récoltés tous ces objets et œuvres d’art dans des situations douteuses voire sanglantes (16). Les personnes racisées se sentent donc privées d’une partie de leur histoire, et certain·e·s ont d’ailleurs tenté de reprendre les biens de leurs ancêtres directement dans les musées comme cela a été le cas en France au Musée du Quai Branly (17) .
Sources :
- R. Lachapelle (1981). Mais qu’est-ce donc que les arts visuels? Liaison, (17), 14–16. https://www.erudit.org/fr/revues/liaison/1981-n17-liaison1165787/43952ac.pdf
- S. Ouanes “Cinq mois après Black Lives Matter, les musées sortent timidement du silence”. Disponible sur https://www.francesoir.fr/, publié le 18 octobre 2020.
- Marie-Laure Allain Bonilla, “ Processus décoloniaux dans l’art : institutions et savoirs “, Critique d’art [En ligne], 52 | Printemps/été, mis en ligne le 27 mai 2020, disponible sur http://journals.openedition.org/critiquedart/46179, consulté le 24 novembre 2021.
- M. Celeux-Lanval “ #BlackLivesMatter : Le monde de l’art à l’épreuve du racisme”. Disponible sur www.beauxarts.com, publié le 18 juin 2020
- DAM, “Pour un processus d’équité culturelle- Rapport de la consultation sur le racisme systémique dans le milieu des arts, de la culture et des médias à Montréal”, disponible sur /www.diversiteartistique.org/, publié en 2018.
- K. Mesbah, “ Secteur culture et artistique belge : quelle place pour les personnes racisées? ” disponible sur www.bepax.or, publié en octobre 2021.
- T. Muteba Luntumbue, “ Secteur culture et artistique belge : quelle place pour les personnes racisées?”,disponible sur www.bepax.or, publié en octobre 2021.
- N. Ver-Ndoye et G. Fauconnier, “Noir entre peinture et histoire”, Ed. Omniscience, 2018.
- Bibliothèque nationale de France, “La figure du Noir dans l’art occidental: représentation, imaginaire et réappropriation”, disponible sur www.bnf.fr, publié en 2019.
- J. Beauzac, “ “Représenter les noir.es : le regard blanc”, disponible sur www.venuslepodcast.com, publié en juin 2020.
- D. Murell, “Seeing Laure: Race and Modernity from Manet’s Olympia to Matisse, Bearden and Beyond”; disponible sur https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8MK69VP, publié en 2014.
- D. E. Pullins, “Review of “Posing Modernity : the black model from Manet and Matisse to today” Wallach Art Gallery, New York and…”, publié en 2018
- Exposition du Musée d’Orsay Paris, “Le modèle noir”, 2019, voir: https://www.offi.fr/expositions-musees/musee-dorsay-2897/le-modele-noir-72857.html
- T. Jourdan, ” Racisme interne au Musée canadien pour les droits de la personne?” Disponible sur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle, publié le 10 juin 2020.
- M. Trochu,”Racisme et culture toxique au musée royal de colombie britannique “, Disponible sur https://canada-info.ca/, publié le 24 février 2021.
- H. Bellet “ Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre ”, sur Arte.tv : des musées européens peuplés d’œuvres volées”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 28 octobre 2021.
- C. Hertzog “ Tentative de vol au Musée du quai Branly : « Ce que je vous dis vient du peuple africain ”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 30 septembre 2020.
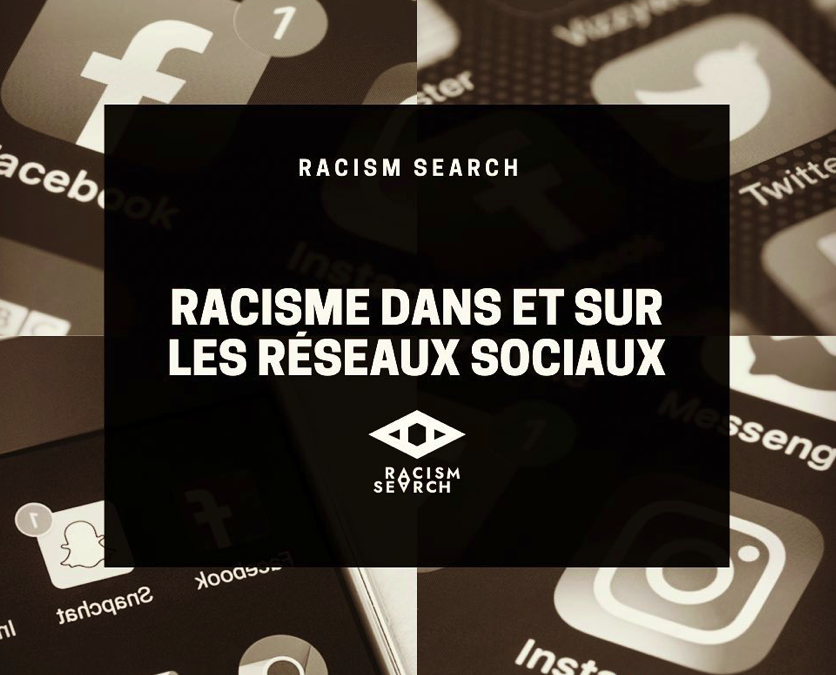
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Discrimination, Général, Racisme
La haine raciale sur les Réseaux Sociaux

Auparavant, les réseaux sociaux n’existaient pas et le racisme n’était visible que dans le “monde réel”, dans la réalité sensible . Or, désormais, en un clic nous disposons de l’information que nous cherchions, nous pouvons communiquer avec des personnes à l’autre bout du monde. Mais loin de n’apporter que des aspects positifs, les réseaux sociaux engendrent des aspects négatifs.
Le déferlement de la haine raciale est l’un d’eux.
En effet, à cause de la popularité des réseaux sociaux, de leur diversité mais aussi de leurs réglementations floues, les discours de haine sont nombreux et se diffusent rapidement sur les différentes plateformes [1]. Alors que des personnes n’oseraient jamais tenir certains propos de visui, Internet devient un défouloir où les langues se délient, de l’#antihomosexuel à #SiMaFilleRamèneUnNoir sous couvert de la “liberté d’expression”[2].
Responsabilité et influence des différentes plateformes
Bien que cela ne soit peut-être pas notre premier réflexe lorsqu’on aborde ce sujet, le racisme sur les réseaux sociaux se manifeste souvent en premier lieu dans la structure et le fonctionnement de la plateforme. En effet, comme le relèvent plusieurs auteurs tels que Marc Faddoul [3] et Sendhil Mullainathan [4], les algorithmes ne sont neutres qu’en apparence.
Ainsi, sur Tik Tok, les recommandations de comptes faites aux utilisateurs se basent sur les caractéristiques physiques des photos de profil des comptes que les utilisateurs suivent déjà. Ce phénomène se nomme “filtrage collaboratif” et peut être problématique car il peut reproduire les préjugés des gens.
“Si la majorité des créateurs populaires sur TikTok sont blancs, par exemple, cela peut empêcher que les créateurs de couleur ayant moins de followers soient vus et recommandés aussi souvent sur la plateforme”[3].
Cela implique également que ces créateurs racisés soient moins rémunérés pour le contenu qu’ils produisent et ne puissent donc pas vivre du fruit de leur travail, et cela non pas à cause de la qualité de leur contenu mais bien à cause des biais des algorithmes.
D’après une enquête du Wall Street Journal [5], les algorithmes employés par Tik Tok recommandent également plus souvent des créateurs correspondant à certains critères de beauté. Si cela est déjà très problématique en soi, les critères sur lesquels se basent ces algorithmes sont des critères de beauté occidentaux, ce qui exclut une fois encore les personnes racisées des recommandations de Tik Tok.
Sendhil Mullainathan, dans un article au New York Times, incite les plateformes à remédier au problème des préjugés algorithmiques, de la manière suivante : en “s’assurer que toutes les données nécessaires à l’algorithme, y compris les données utilisées pour le tester et le créer, sont soigneusement stockées ” [4].
Des contenus à connotation raciste …
En second lieu, le racisme est également présent via le contenu partagé sur les réseaux.
Le cas Tiktok
 Comme mentionné dans le point précédent, la popularité est liée à la question algorithmique. D’ailleurs, un #BlackTikTokStrike a débarqué sur les réseaux pour dénoncer l’appropriation culturelle* des danses issues de la communauté noire. Beaucoup de tiktokeurs et influenceurs blancs reprennent – consciemment ou non – des danses qui deviennent virales, sous leur nom.
Comme mentionné dans le point précédent, la popularité est liée à la question algorithmique. D’ailleurs, un #BlackTikTokStrike a débarqué sur les réseaux pour dénoncer l’appropriation culturelle* des danses issues de la communauté noire. Beaucoup de tiktokeurs et influenceurs blancs reprennent – consciemment ou non – des danses qui deviennent virales, sous leur nom.
Ce qui est décrié est le peu de popularité de ces danses lorsqu’elles sont exécutées par les auteurs noirs qui, par conséquent, ne perçoivent pas les retombées de leur création .. [7]
La plateforme réagit :
“Nous nous soucions profondément de l’expérience des créateurs noirs sur notre plateforme et nous continuons à travailler chaque jour pour créer un environnement de soutien pour notre communauté, tout en instillant une culture où honorer et créditer les créateurs pour leurs contributions créatives est la norme.” [7]
L’ISD (Institute for Strategic Dialogue) s’exprime à travers d’un rapport sorti en août 2021 “TikTok fonctionne comme une nouvelle arène pour les idéologies haineuses incitant à la violence.” [6] Des vidéos qui rient et nient l’Holocauste et l’instrumentalisation d’une chanson juive (Hava Nagila) sont des exemples percutants dénoncés par l’ISD [6]. Ils sont représentatifs d’une transmission de haine raciale.
Sur Instagram, on peut rappeler le challenge lancé par la star de Télé-réalité Jazz qui s’est peint la moitié du visage en noir. Consciente ou non de son acte, elle s’est vite fait lourdement critiquée par les internautes [8]. Cette pratique nommée “BlackFace” est fortement empreinte de connotations racistes**. Avec les médias virulents, ce genre d’accident peut vite être repris par des personnes qui ont peu de recul critique sur lesréseaux sociaux, ou qui sont juste inconscientes de la problématique.
Les commentaires des utilisateurs
Nous en parlions déjà dans notre article sur le racisme en milieu sportif lorsque nous soulignions les commentaires haineux qu’on subit les joueurs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro. Les internautes jouent aussi un grand rôle dans la propagation de la haine raciale sur les réseaux sociaux.
Nous avons déjà tous vu des commentaires racistes sous des articles parlant d’immigration par exemple ou des incitations à la haine raciale sur des réseaux tels que Twitter ou Instagram. Ces commentaires vont même parfois jusqu’à des appels aux meurtres, et bien que l’option “signaler ce commentaire” ou cette publication existe, il est à noter que les géants d’Internet sont généralement peu réactifs [9]. Ces outils de signalement ont été utilisés sur trois grandes plateformes ( Instagram, facebook et youtube) par L’UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie et uniquement 77 contenus ont été supprimés sur les 548 signalés [10].
Equilibre entre la liberté d’expression et le devoir d’action
Si une majorité d’internautes est consciente que de tels propos ont des impacts au-delà des réseaux sociaux, l’absence de conséquences sur la sphère digitale est une raison qui pousse à exprimer ouvertement une intolérance et/ou une haine envers certains groupes de personnes. Ce qu’il reste intéressant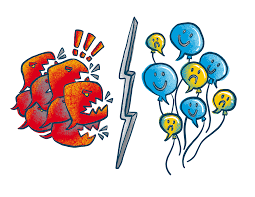 à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit d’exprimer son opinion ou ses idées sans qu’une réprobation ne puisse être prise à l’égard de son auteur et ce, même si ces idées sont inconvenantes, déplacées, et outrageuses [11].
à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit d’exprimer son opinion ou ses idées sans qu’une réprobation ne puisse être prise à l’égard de son auteur et ce, même si ces idées sont inconvenantes, déplacées, et outrageuses [11].
Toutefois, dans ce grand nombre de personnes qui invoquent la liberté d’expression pour vociférer des propos racistes et discriminatoires, peu importe la limite imposée à cette liberté, lorsque ces propos révèlent une incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou à la ségrégation à l’égard d’autrui sur un lieu public* [11].
S’il est possible d’obtenir une condamnation pour ce type de propos en justice, il faut se demander s’il n’y a pas un moyen de prévenir ce type de comportement sur les réseaux sociaux.
*Notons qu’un lieu public désigne également tout message, vidéo ou photo sur internet qui est communiqué ou accessible à une ou plusieurs personnes.
Les plateformes sont les vecteurs principaux de la propagation du racisme. Elles ont une responsabilité à l’égard de la société d’introduire des règles de conduite et des sanctions suffisantes pour dissuader ce genre de commentaires. Cela est notamment appuyé par l’Union européenne qui a imposé une condamnation financière à tout réseau social qui ne respectait pas les réglementations luttant contre le racisme [12].
Au vu de ces règles et notamment de l’intervention de la justice, nous pouvons constater que certaines actions ont été entreprises par les plateformes digitales afin de remédier à ce problème. Ainsi, par exemple, il a été révélé par l’Unia que les plateformes ont employé du personnel chargé de nettoyer les commentaires haineux, dangereux et discriminatoires [12].
Toutefois, l’afflux de haine sur les réseaux ne fait qu’augmenter et certains doutent de la réelle effectivité du plan d’action de ces plateformes. A titre illustratif, le réseau Twitter a récemment été assigné en justice par quatre associations luttant contre des discriminations pour son manque de réelles actions [13]. Ceci n’est qu’un exemple de l’écart entre le devoir d’action des entreprises et la mise en œuvre d’une véritable restriction. Mais expliqué ci-dessus, le même problème est toujours observé sur les autres plateformes populaires sur lesquelles il reste possible de véhiculer des discours racistes sans réelle conséquence.
* N’hésite pas à aller lire l’article sur l’appropriation culturelle pour en savoir d’avantage (12 avril 2021)
** Notre position sur le phénomène “BlackFace” est expliquée dans l’article “Pourquoi le père fouettard est-il problématique?” (6 décembre 2020)
SOURCES :
[1] A. de Latour, N. Perger, R. Salaj, C. Tocchi, P. Viejo Otero, C. Del Felice et M. Ettema, R. Gomes, “Alternatives: Les contre-récits pour combattre le discours de haine ”, Strasbourg, France: Conseil de l'Europe, 2017, p. 45.
[2] G. Peronne, “Discrimination et réseaux sociaux”, disponible sur www.pnrs.ensosp.fr, Décembre 2014.
[3] Forbes, “Tik Tok : la plateforme est-elle raciste?”, disponible sur www.forbes.fr, publié le 15 avril 2020
[4] The New York Times, “Biased algorithms are easier to fix than biased people”, disponible sur www.nytimes.com, publié le 06 décembre 2019.
[5]The Wall Street Journal, “Inside Tik Tok’s algorithm: a WSJ video investigation”, disponible sur www.wsj.com, publié le 21 juillet 2021.
[6] Protestinter, A. Molina, “Tiktok gangrené de contenus racistes, antisémites et islamophobes” disponible www.reformes.ch, publié le 31 août 2021
[7] Courrier International, “ #BlackTikTokStrike, le mouvement de révolte des danseurs noirs”, disponible sur www.courrierinternational.co , publié le20 juillet 2021
[8] G. Dauge, “PHOTO Jazz (JLC Family) accusée de “blackface”, elle supprime son dernier cliché qui fait polémique”, disponible sur www.voici.fr, publié le 1 juin 2021
[9] C. Belaïch , “ Peut-on lutter contre l’incitation à la haine sur les réseaux ”, disponible sur www.liberation.fr, publié le 13 mai 2016.
[10] SOS Racisme, “ SOS Racisme, SOS Homophobie et l’UEJF étrillent Twitter, YouTube et Facebook”, disponible sur www.sos-racisme.org, consulté le 16 octobre 2021.
[11] UNIA, “Les limites à la liberté d’expression”, disponible sur https://www.unia.be, consulté le 15 octobre 2021.
[12] K. Azzouz, “Racisme et réseaux sociaux : l'impunité s'est pris les pieds dans la toile”, disponible sur https://www.rtbf.be/, publié le 19 février 2020.
[13] Martin Untersinger, “ Twitter assigné en justice pour son « inaction massive » face aux messages haineux”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 12 mai 2020.
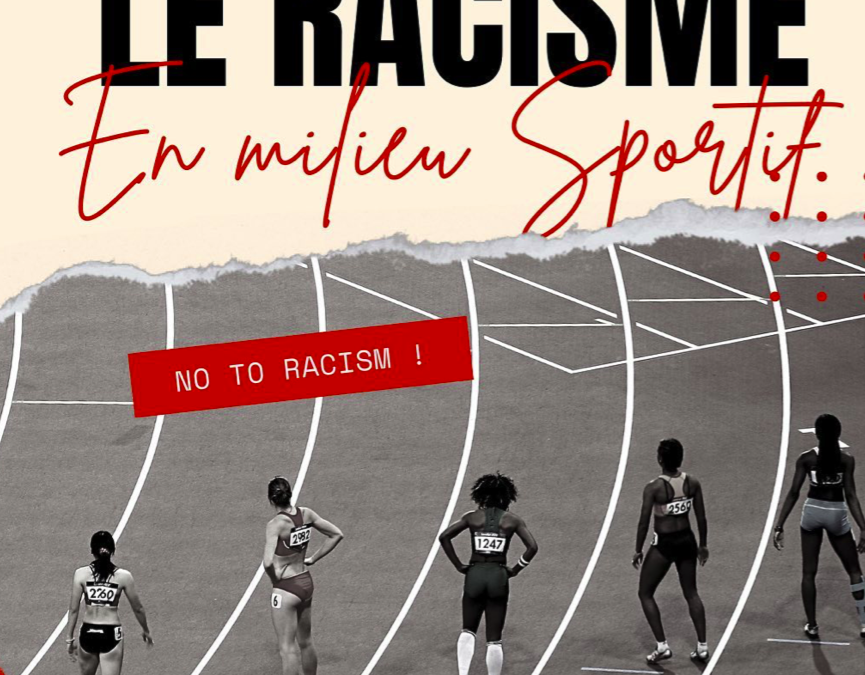
par racism-search | Juin 6, 2022 | Articles, Discrimination, Général
Le racisme dans le milieu sportif
Récemment au cœur de l’actualité, le racisme dans le domaine sportif connaît un essor particulièrement inquiétant.
En effet, nous sommes témoins d’un nombre impressionnant de comportements racistes et discriminatoires spécifiquement dirigés à l’encontre des personnes racisées au sein de divers domaines sportifs. Tant les supporters que certaines organisations sportives perpètrent un environnement toxique et dangereux à la fois mentalement et physiquement pour les personnes racisé.e.s.
Des objets, des aliments tels que des bananes ou des injures sont par exemple lancés aux personnes noires, elles sont huées par les foules et victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux [1] [2]. Il peut être étonnant que le sport, domaine censé rassembler le peuple et créer une certaine cohésion nationale, soit le vecteur de tant de racisme. Ainsi, “les actes racistes révèlent les contradictions du sport, car ses valeurs sont celles d’un langage universel qui promeut le respect et l’ouverture aux autres” [1].
Ce qu’il est important de noter c’est que ces actes restent souvent impunis [1] et ce, même s’il existe des organisations telles que la LICRA qui lutte et aide les victimes de racisme dans les mouvements sportifs. C’est pourquoi certains mouvements de protestation commencent à s’organiser pour pointer du doigt le problème. Ainsi, à titre illustratif, un boycott des réseaux sociaux avait été aménagé du 30 avril au 3 mai 2021 par les clubs de football anglais (qui a par la suite motivé d’autres équipes du monde à faire de même) [2].
En effet, les réseaux sociaux n’ont fait qu’accentuer le racisme dans le sport. La possibilité de commenter les prestations des athlètes en direct a permis de démontrer que les personnes racisées ne possèdent pas la même marge d’erreur et qu’elles provoquent une sympathie limitée du public. Une simple défaite est suffisante pour passer d’héros à ennemi de la société. De plus, nous remarquons que les aptitudes et capacités des personnes racisées sont constamment remises en cause, les obligeant à passer davantage de tests et à se prouver régulièrement.
Exemple de cas concrets de racisme dans le milieu sportif
1. Le racisme au sein du football
Les exemples de racisme dans le milieu du football sont malheureusement nombreux. Vous vous en souvenez sûrement tous car cela s’est passé il y a seulement quelques mois, mais un exemple marquant est la déferlante de haine qu’ont subi trois joueurs anglais après la défaite de l’Angleterre face à l’Italie lors la finale de l’Euro 2020 [3]. En effet, après avoir manqué leur tir au but, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Loin d’être un événement anodin, le ministre de la culture et des sports, Olivier Dowden, a demandé à ce que les plateformes de réseaux sociaux s’attaquent et punissent davantage le racisme en ligne [4]. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la FA, les clubs de la Premier League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine ainsi que des organisations représentants les principaux acteurs du football ont décidé de ne rien publier sur leur réseaux entre le 30 avril et le 3 mai pour mettre l’accent sur la situation alarmante du racisme dans le milieu du football [4]. D’autres cas, tels que les insultes qu’ont reçu les joueurs roumains du Dinamo Bucarest par les supporters de la Lazio Rome durant leur match à Rome, démontrent encore une fois que le racisme dans le monde du football est autant présent en ligne que sur le terrain [5].
Cependant, il est à noter que ce ne sont pas seulement les supporters qui adoptent des comportements racistes mais aussi les corporations sportives en tant que telles. Par exemple, en 2010, Médiapart a révélé que la Direction technique nationale “ aurait émis la volonté de limiter, voire d’« éradiquer » les joueurs binationaux évoluant dans des équipes africaines et nord‐africaines, et les joueurs dits « costauds » – les « Blacks »” lors de leurs sélection de jeunes joueurs [6].

Etienne Bonamy, « Racisme dans le football: on arrêtera autant de matchs qu’il le faudra », L’Humanité, publié le 30 octobre 2023, disponible sur https://www.humanite.fr/sports/football/racisme-dans-le-football-on-arretera-autant-de-matchs-quil-le-faudra
Le combat pour éradiquer le racisme dans le monde du football est encore long et doit se faire tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein des institutions sportives.
2. Mysogynoir* dans l’athlétisme
Un exemple marquant du racisme dans le sport est celui de Caster Semenya. Cette athlète est double championne olympique et triple championne du monde sur 800m mais, en 2020, elle est contrainte d’arrêter sa pratique sportive. En effet, la fédération internationale d’athlétisme lui a imposé de prendre des traitements pour diminuer son taux de testostérone car son hyperandrogénie** l’avantagerait trop face à ses concurrentes. Caster Semenya a refusé de se plier à cette exigence, il lui a été, dès lors, interdit de participer aux différentes compétitions.
Outre les questions qui se posent vis-à-vis de la place des personnes intersexes dans le sport et, de manière plus générale, vis-à-vis du sexe comme construction sociale, il est particulièrement important de relever ici le racisme qui sous-tend le contrôle et les pressions subis par Caster Semenya. Bien qu’elle dispose d’un palmarès impressionnant, elle n’est pas l’athlète féminine la plus rapide du monde sur 800m, mais les athlètes se trouvant au-dessus d’elle dans les rankings sont blanches et/ou correspondent aux standards de la « féminité » occidentale et n’ont donc jamais dû se soumettre à des tests hormonaux[7].
Le cas de Caster Semenya n’est pas isolé, puisque la majorité des athlètes qui ont subis des pressions de la part de la fédération internationale d’athlétisme pour prendre des traitements et donc modifier leurs corps, pourtant en bonne santé, sont des athlètes racisées comme Santhi Soundarajan, Dutee Chand, Nancy Navalta et le plus souvent noires telles que Francine Niyonsaba, Margaret Wambui, Aminatou Seyni…[8]
Malheureusement, les athlètes ne sont pas les seules sportives racisées à être stigmatisées pour leur prétendu manque de féminité, c’est également le cas des joueuses de tennis Serena et Vénus Williams, de la judokate Edinanci Silva ou encore de la patineuse Surya Bonaly [8].
3. Insultes anti-asiatiques
Dans le domaine sportif, le racisme anti-asiatique surgit également sous différentes formes. Que ce soit par communication orale ou virtuellement, beaucoup de sportif.ve.s professionnel.le.s d’origine asiatique sont sujets à des insultes racistes. Depuis l’épidémie de la covid, ce phénomène s’est amplifié aux Etats-Unis. [9] Donald Trump, ancien Président des USA, qualifiait d’ailleur le virus de “peste chinoise” à l’époque de son apparition. [9]
Chloe Kim, championne olympique de snowboard, en a fait les frais via les réseaux sociaux. Née en Californie de parents coréens, elle reçoit chaque jour des insultes anti-asiatiques depuis 2014, année au cours de laquelle elle gagne une médaille d’argent au X Games à Aspen (Colorado). Aujourd’hui, ce sont des centaines d’injures par mois qu’elle reçoit. [10] Elle affirme d’ailleurs, dans un entretien sur la chaîne ESPN, ne plus oser sortir de chez elle sans moyen de défense.[10]
Sakura Kokumai, karatéka américaine d’origine asiatique, a subi des injures lorsqu’elle s’entraînait dans un parc (Caroline du Sud). En effet, un homme lui a lancé des propos racistes et discriminants pendant sa session de sport. Elle se dit particulièrement étonnée par la violence de l’homme et la passivité des passants qui ont vu et observé la scène ; ils n’ont rien dit. [11] Cette passivité ne signifie pas nécessairement l’accord du “public”, mais prouve qu’un travail de dénonciation est nécessaire pour faire passer ce genre d’attitude dans l’ordre de l’impensable et l’inacceptable. Le racisme banalisé se trouve aussi là, dans le non-dit.
Les deux cas présentés ci-dessus ne sont que des exemples, parmi tant d’autres. Un Centre d’étude à l’Université de San Bernadino en Californie affirme que les violences envers les américains asiatiques ont très fortement augmenté en 2020 [9]. Ces insultes racistes sont particulièrement alarmantes. Actes de violence et de haine, ils déferlent dans le monde sportif et ont un impact considérable. Néanmoins, des gestes de protestations diffusés en direct ou via les réseaux sociaux par les sportifs professionnels permettent de transmettre des messages politiques et leur engagement dans la cause anti-raciste. [12]
Lexique
*Mysogynoir: Ce terme, inventé Moya Bailey, une académique queer noire et féministe, désigne une forme de misogynie envers les femmes noires dans laquelle la race et le genre jouent un rôle concomitant.
** Hyperandrogénie: Cela désigne une surproduction de testostérone.
Sources
[1] V. Sassoon, “Sport et discrimination : le regard des media”, Séminaire organisé par le secrétariat de la Campagne Dites Non à la discrimination du Conseil de l’Europe, disponible sur www.coe.int, consulté le 24 septembre 2021.
[2] T. Delaunay, “ Contre le racisme, le monde du sport va boycotter les réseaux sociaux ce week-end”, disponible sur www.huffingtonpost.fr, publié le 30 avril 2021.
[3] Le Figaro, “Euro: après la finale perdue, flot d'insultes racistes sur trois joueurs anglais”, disponible sur www.lefigaro.fr , publié le 17 juillet 2021.
[4] Le Monde, “ Euro 2021 : Boris Johnson dénonce les insultes racistes visant des joueurs anglais après leur défaite en finale”, disponible sur www.lemonde.fr, publié le 12 Juillet 2021.
[5] K. Wachter, “Le racisme dans le football –le football contre le racisme L'expérience de fare”, disponible sur www.un.org, consulté le 25 septembre 2021.
[6] A. Oualhaci, “ Etre sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 311.
[7] Tout va bien, “Caster Semenya ou comment le sexe est une construction sociale”, disponible sur www.toutvabien.tv, publiée le 19 avril 2021.
[8]A. Oualhaci, “Être sportif et racisé, entre essentialisation et émancipation”, in Omar Slaouti et al., Racismes de France, La Découverte, Paris, 2020, p. 318.
[9] E. Degbe, “Contre le racisme anti-asiatique aux Etats-Unis, les prises de paroles se multiplient” disponible sur https://www.huffingtonpost.fr, publié le 25 avril 2021
[10] Ouest-France, “Racisme. La championne olympique de snowboard Chloe Kim bombardée d’insultes anti-asiatiques” disponible sur https://www.ouest-france.fr, publié le 2 avril 2021
[11] J. Harvey “ U.S. Olympic Athlete Sakura Kokumai Targeted in Racist Attach”, disponible sur https://www.huffpost.com, publié le 4 septembre 2021
[12] E-Tvsport, “Des gestes de protestation restés mémorables dans le monde su sport”, disponible sur https://www.sports.fr, publié le 25 septembre 2017
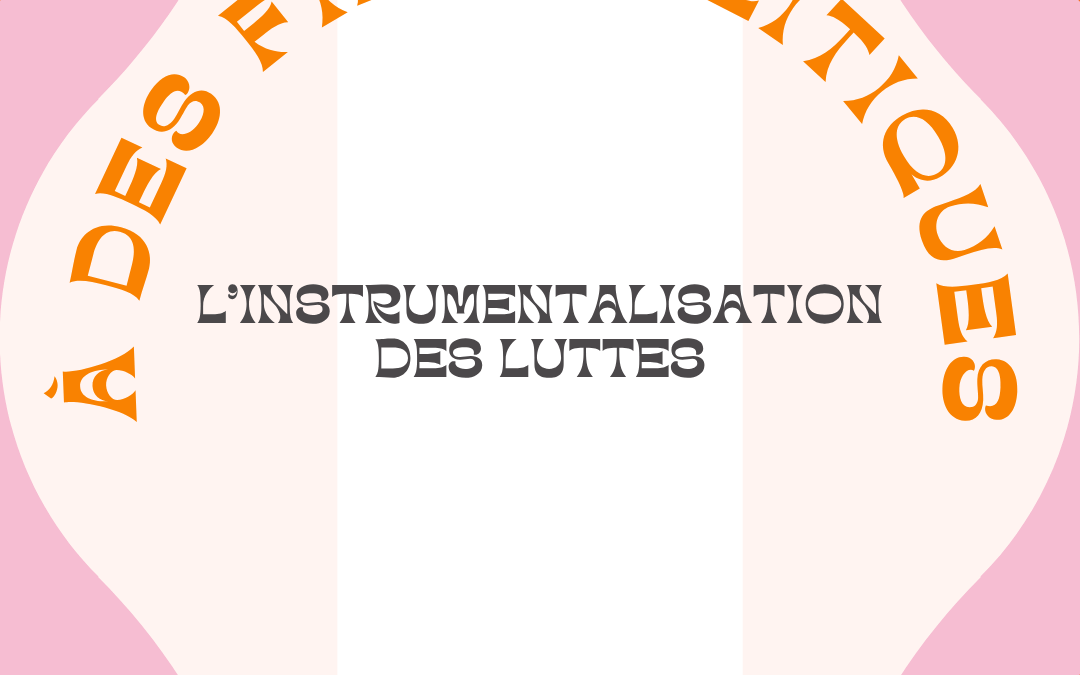
 source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken
source : Article le Soir publiée le 17/10/2014 https://www.lesoir.be/art/683200/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-10-17/petits-cons-marocains-nouvel-e-mail-douteux-pour-theo-francken
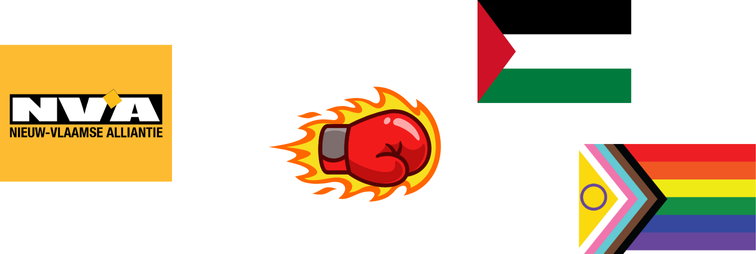

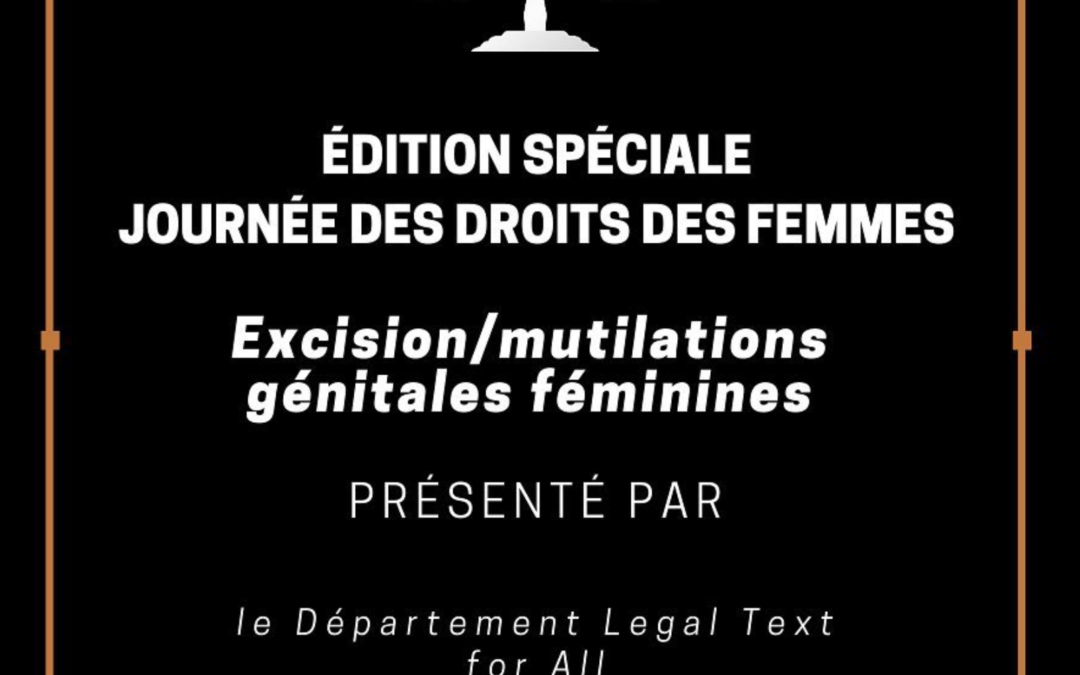

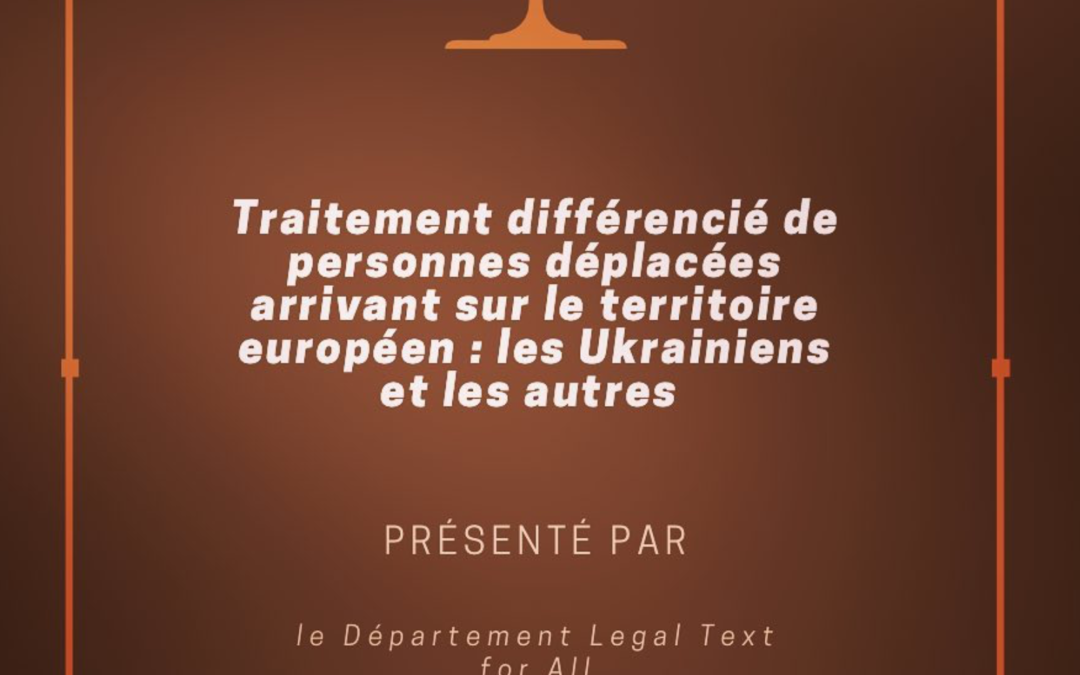

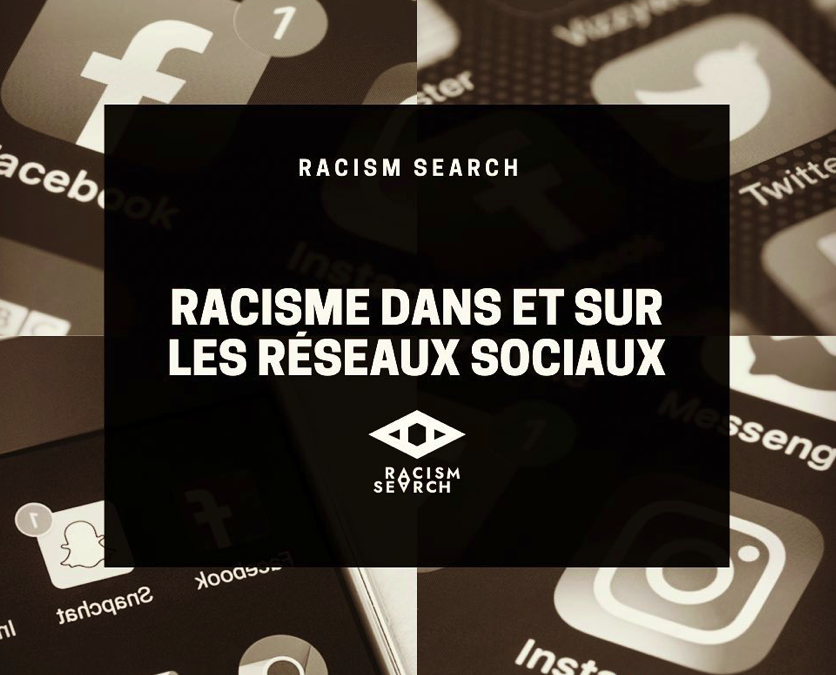

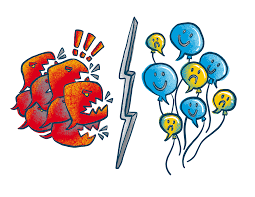 à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit
à noter est la justification souvent apportée à ces propos : la liberté d’expression. Il s’agit du droit