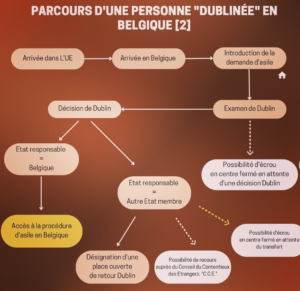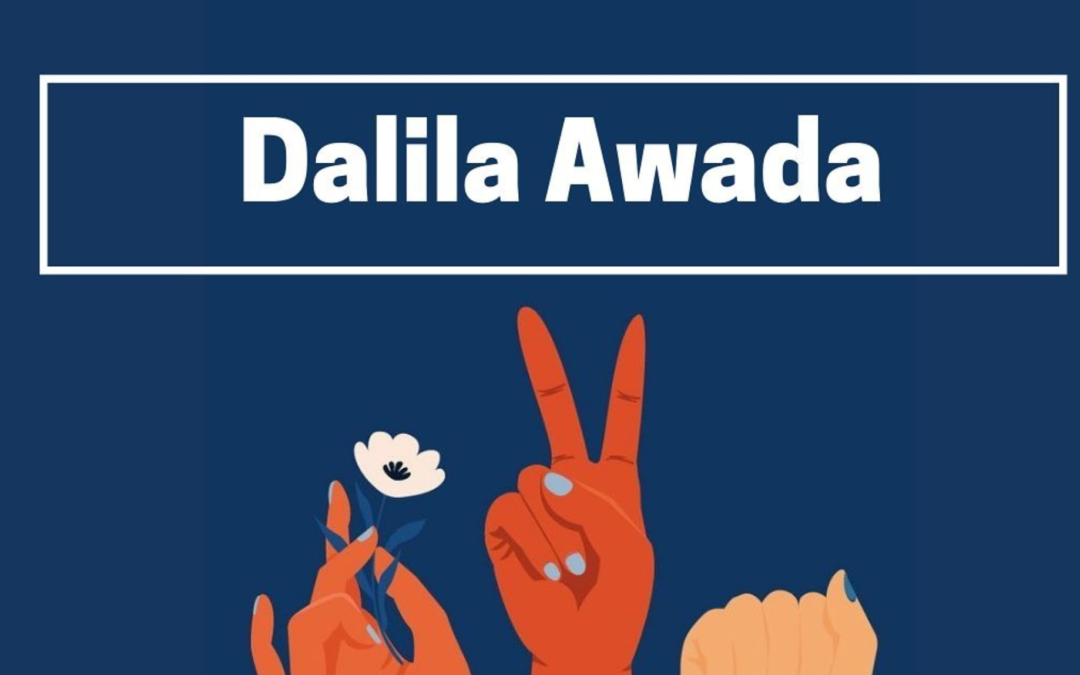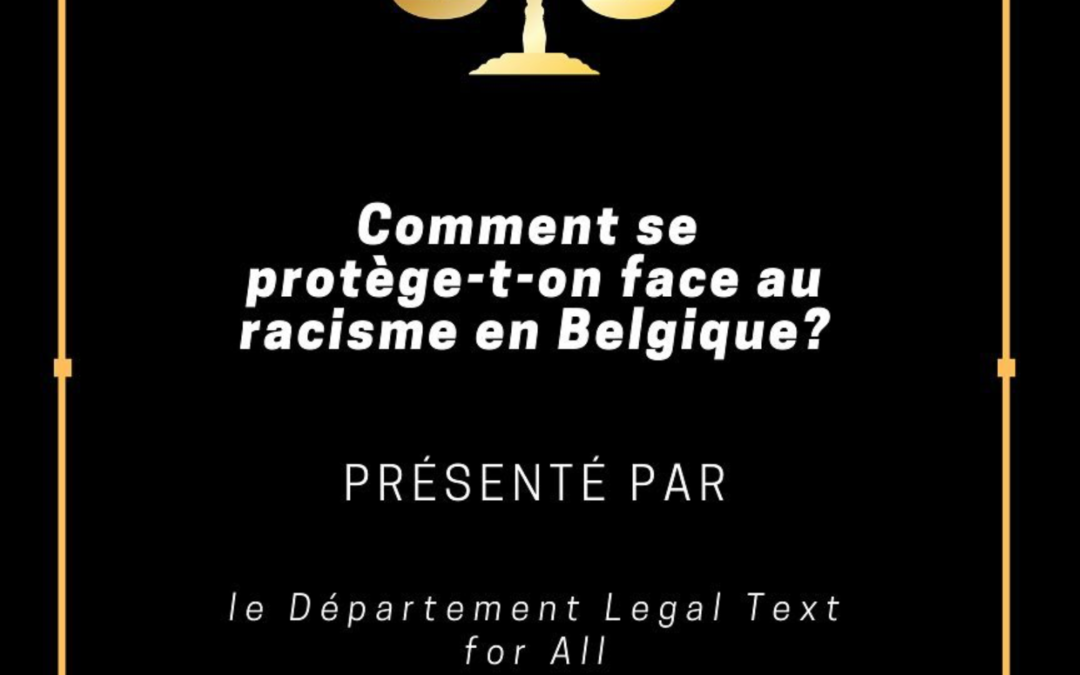par Cyril Martin | Jan 16, 2024 | Articles, Belgique, Legal Text For All
Les discriminations subies par les personnes en séjour irrégulier
Nous allons aborder le thématique de la discrimination sous un angle quelque peu différent, en partant d’un public-cible, bien spécifique : les personnes qui sont sans papiers, c’est-à-dire les personnes en séjour irrégulier.
A noter que l’on préfèrera l’expression de personnes en séjour « irrégulier » qu’en séjour « illégal », au vu de la connotation péjorative qui entoure la notion d’illégalité.
La situation des personnes en séjour irrégulier en Belgique
En Belgique, on estime à 1000.000 le nombre de personnes vivant en situation de séjour irrégulier [1].
Parmi ces personnes, certaines ont énormément de points d’accroche avec la Belgique : certaines y sont nées y ont suivi une partie ou l’entièreté de leur parcours scolaire ou encore ont des arrivants qui vont à l’école. Beaucoup sont intégrées depuis des années, travaillent, ont des amis et de la famille en Belgique et y ont tout simplement construit leur vie. Pourtant, si tous ces éléments nous font penser à n’importe quel citoyen belge lambda, les personnes sans-papiers vivent une réalité totalement différentes des personnes en séjour régulier. Car comme l’énonce le Ciré, une ASBL de lutte pour les droits des personnes exilées : « être sans papiers, c’est mener une existence précaire et subir des discriminations continuelles » [2].
Les discriminations subies par les sans-papiers sont nombreuses. Ne pouvant travailler qu’au noir, les personnes en séjour irrégulier sont très souvent exploitées par un « employeur » se trouvant en situation de dominance. Les sans-papiers sont victimes de marchands de sommeil, qui profitent de la situation précaire des sans-papiers pour leur proposer des habitations vétustes voire délabrées à des prix exorbitants.
Plus encore, les sans-papiers ayant toujours la crainte d’être arrêtés ou expulsés et n’ayant pas toujours la possibilité de s’informer correctement, ne font pas appel à des services essentiels tels que ceux de la santé ou de la justice. Ainsi, ils portent rarement plainte, ne vont pas chez le médecin ou même à l’école [1] [3].
Finalement, l’on voit que les droits les plus fondamentaux des sans-papiers ne jouissent pas des mêmes garanties que ceux des citoyens belges. Même dans le cadre d’une régularisation, certaines discriminations sont subies.
La politique de régularisation belge : la régularisation sur base des articles 9bis et 9ter
Pour pouvoir être régularisés en Belgique, cela peut se faire de deux façons différentes : soit via une régularisation individuelle, soit via une régularisation dite « collective », ce qu’on appelle également « une vague de régularisation ». Abordons, premièrement, la régularisation individuelle : elle se fait sur base de la loi du 15 décembre 1980. Pour pouvoir être régularisé, il faut répondre soit au prescrit de l’article 9 bis, soit de l’article 9ter. L’article 9ter permet à un étranger de demander l’autorisation de séjour s’il « dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’ik n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ». Cet article permet donc d’introduire une demande de régularisation pour motif médical auprès de l’Office des étrangers [4].
Néanmoins, au vu des strictes balises contenues dans l’article 9ter et de l’appréciation souvent trop stricte de la gravité de la maladie par l’administration, peu de demandes sont acceptées pour ce motif [5]. L’article 9bis permet, quant à lui, à un étranger de demander une autorisation de séjour « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité ».
Cet article pose un problème fondamental : il ne contient aucun critère clair et objectif sur lesquels fonder une décision de régularisation. Ainsi, l’administration a un très large pouvoir discrétionnaire d’interpréter comme bon lui semble la notion « circonstances exceptionnelles ».
La politique de régularisation belge : la régularisation collective
A côté de la régularisation individuelle sur base des articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980, il y a ce qu’on appelle la régularisation collective, qui est une décision du gouvernement d’accorder un droit de séjour à des étrangers à un moment T. Des critères de régularisation sont alors fixés de façon temporaire. En Belgique, il y a eu deux grandes vagues de régularisation qui sont intervenues en 1999 et en 2009. Si l’on peut se réjouir du fait que les étrangers présents sur le territoire en 1999 et en 2009 aient pu obtenir un titre de séjour, ces régularisations se sont également faites au détriment des personnes en situation de séjour irrégulier n’étant pas encore présentes sur le territoire. Cette situation crée une sorte de discrimination temporelle car la régularisation des sans-papiers repose exclusivement sur le hasard ! [6]
Ainsi, ceux qui ont « la chance » de se trouver sur le territoire au moment où le gouvernement décide d’entamer une vague de régularisation se voient conférer un titre de séjour. De façon injuste, ceux qui ne se trouvent pas encore sur le territoire ou ceux qui viennent de partir volontairement chez eux, renonçant à leur rêve de rester vivre en Belgique, n’ont pas ce privilège.
Comment combler les lacunes de la politique migratoire belge ?
L’ISEF est l’acronyme de l’Indice Socio-Economique Faibles. Il s’agit d’un mécanisme créé par le gouvernement de la Communauté Française en 2009, en vue de classifier les écoles primaires situées dans une zone socio-économique précarisée.
Chaque année, des milliers de parents se vouent à une lutte sans merci pour inscrire leur enfant dans l’école idéale. Certains se satisfont automatiquement de leur deuxième ou troisième choix pensant n’avoir aucune chance par faute de moyens.
L’ISEF agit comme critère de distinction des candidatures lors de la phase d’inscription dans une école secondaire. Dès lors, il permet aux enfants sortant d’une école ISEF, d’être prioritaires. Ainsi, une école secondaire réputée d’Uccle se doit de prévoir 20,4% de sa capacité aux étudiants ISEF. Il ne reste donc qu’aux parents d’oser candidater auprès de ‘l’école de leur choix. Mais le constat est clair : peu connaissent l’existence de l’ISEF. Et comme l’explique Michel Parys, co-président de la régionale bruxelloise de l’UFAPEC, c’est l’inverse qui se produit. En effet, les parents souhaitant naturellement la meilleure formation pour leur enfant, choisissent bien souvent de l’inscrire au sein d’une école primaire loin de leur quartier précarisé, dans des écoles non ISEF.
Sources
[1] ASBL Ciré, « 110 000 une estimation du nombre d’étrangers en situation irrégulière en Belgique », disponible sur https://www.cire.be/le-chiffre-110-000-une-estimation-du-nombre-d-etrangers-en-situation-irreguliere-en-belgique/
[2] ASBL Ciré , « Sans-papiers, avec critères ! », disponible sur https://www.cire.be/chronique-sans-papiers-avec-criteres/
[3] « Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue d’y insérer des critères clairs, justes et précis de régularisation pour les personnes en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Royaume et instituant une Commission indépendante de régularisation », disponible sur https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1415/55K1415001.pdf
[4] Medimmigrant, « Autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter) », disponible sur https://medimmigrant.be/fr/infos/sejour-ou-retour-en-cas-de-maladie/autorisation-de-sejour-pour-raisons-medicales-art-9ter
[5] ADDE, Livre blanc sur l’autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter)
[6] Wavreille Aime, « Régularisation des sans-papiers : des critères trop flous et trop arbitraire ? », la RTBF, disponible sur https://www.rtbf.be/article/regularisation-des-sans-papiers-des-criteres-trop-flous-et-trop-darbitraire-10780959
par Cyril Martin | Jan 16, 2024 | Articles, Droits, Legal Text For All
Traitement différencié de personnes déplacées arrivant sur le territoire européen : les Ukrainiens et les autres

Comment l’UE soutient l’Ukraine en 2023 | Actualité | Parlement européen (europa.eu)
Introduction
En droit international, il existe de manière générale une protection de tou.te.s les réfugié.e.s offerte par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (dite convention de Genève). Cette Convention oblige les États signataires à accueillir toute personne fuyant la guerre.
Dans le cadre du conflit armé entre l’Ukraine et la Russie ,1 instrument spécifique a cependant été utilisé en Europe la Directive 2001/55/CE, connue sous le nom de directive de protection temporaire.
Qu’est-ce que c’est ?
La directive de protection temporaire a été créée en 2001 après les conflits dans les Balkans et a été transposée en droit belge par la loi du 18 février 2003 [1].
Elle a la particularité de ne pouvoir être appliquée que par une décision de Conseil de l’Union Européenne à la majorité qualifiée de ses membres et sur proposition de la Commission.
Cette directive européenne n’avait jamais été mise en œuvre avant 2022 et l’arrivée des réfugié.e.s ukrainien.ne.s fuyant le conflit entre l’Ukraine et la Russie sur le sol européen.
Qu’est-ce que cette directive prévoit ?
Cette directive apporte une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées en cas d’afflux massif sur le territoire européen, leur offrant plus d’avantages qu’aux personnes arrivant sur le sol européen en d’autres circonstances. Ces différents avantages s’appliquent aux ressortissant.e.s ukrainien.ne.s ainsi qu’aux membres de leur famille, aux apatrides et aux ressortissant.e.s de pays tiers auxquels l’Ukraine a octroyé la protection internationale ou nationale. Les personne considérées comme « étant en séjour légal » en Ukraine sont donc visées par cette directive, à l’inverse de celles qui ne le sont pas.
Concrètement la protection temporaire prévue par la directive se traduit par un titre de séjour dans l’Etat membre qui est valable pendant toute la durée de la protection. Les personnes pourront ainsi travailler, accéder à l’enseignement, recevoir un logement approprié ainsi qu’une aide sociale et financière, ou encore des soins médicaux.
Grâce à cette protection immédiate, ces personnes évitent de lourdes procédures administratives. Il ne faut en effet plus que les réfugiés ukrainien.ne.s introduisent individuellement une demande de protection internationale ou subsidiaire : la protection temporaire et tous les avantages qu’elle inclut lors sont octroyés par le simple fait qu’ils fuient le conflit armé.
Cependant, cette protection est temporaire : elle s’applique pour un an seulement et ne peut être prolongée que pour 2 ans au maximum. Le Conseil de l’Union Européenne peut également mettre fin à la protection s’il estime que les personnes sont en mesure de retourner dans leur pays d’origine de manière sûre.
Quel(s) problème(s) cela pose-t-il ?
Bien que cette directive existe depuis 2001, le Conseil de l’Union Européenne l’a adopté pour la première fois le 3 mars 2022. La protection prévue par la directive a donc été activée pour la première fois dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine et pour répondre à l’avis de personnes ukrainiennes sur le territoire européen.
Or, la mise en œuvre de cette directive aurait pu être précieuse lors de bien d’autres afflux de personnes déplacées ayant précédemment eu lieu sur le sol européen. Son activation avait d’ailleurs déjà été sollicitée.
En 2011, deux États membres, l’Italie et Malte, ont demandé à la Commission européenne l’activation de la directive. Aucune suite n’a pourtant été donnée à cette demande.
Lors des importants flux migratoires de 2015 et 2016, le Parlement européen a adopté deux résolutions appelant la Commission et le Conseil de l’Union européenne à mettre en œuvre la même directive.
En guise de réponse, la Commission publie un rapport d’analyse mettant en avant une définition très large des termes « arrivée massive ». Aucune suite n’avait été donnée à cela et la Commission avait ainsi décidé de ne pas enclencher le processus de mise en œuvre.
De façon paradoxale, cette directive a été conçue dans un objectif de rapidité et de réactivité, pour éviter le surchargement administratif que subissent les structures d’accueil lors d’arrivées massives de personnes déplacées. Cet objectif ne peut cependant être atteint que moyennant un accord entre les différents Etats et après une procédure d’activation complexe au niveau des institutions européennes.
De plus, la Commission européenne et les États membres de l’Union n’ont jamais vu d’utilité à exploiter cet instrument. Cette directive n’a en effet pas été placée comme un instrument à utiliser en priorité mais la Commission européenne et les États membres ont préféré mettre en œuvre des mécanismes alternatifs, tels que le régime d’asile européen commun ou de soutien financier aux diverses agences européennes, privilégiant un système de relocalisation tel que prévu dans le règlement Dublin III.
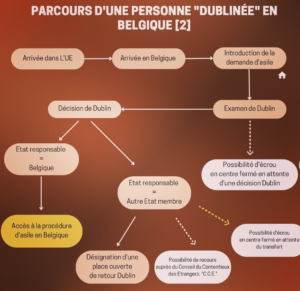
Ces solutions alternatives et la difficulté d’activation de la directive ont abouti à la non mise en œuvre de cette directive ce qui témoigne d’un manque de volonté politique à l’utiliser pour les afflux migratoires sur le territoire de l’Union.
De ses choix politiques, il résulte un traitement différencié des personnes migrantes arrivant sur le territoire européen des dernières décennies. Les Ukrainien.ne.s ont en effet bénéficié d’un accueil plus favorable que les personnes en provenance des pays non-européens.
Pourquoi l’activation de la Directive Protection temporaire a-t-elle tout à coup été possible ? Pourquoi aussi rapidement ? Pourquoi cet afflux d’Ukrainien.ne.s a-t-il été considéré par la Commission européenne comme une « arrivée massive » tandis que cela n’a pas été le cas lors des afflux en 2015 provenant du Moyen-Orient ?
À titre indicatif, nous savons que des cas de discriminations ont été recensé aux frontières polonaises, où des personnes en provenance d’Afrique ont été refoulées pour donner priorité à des personnes ukrainiennes. Cette discrimination commence même parfois dès la frontière ukrainienne, frontière à laquelle certains gardes-frontière ukrainiens ont empêché les personnes noires de traverser la frontière pour donner priorité aux personnes ukrainiennes blanches.
Dès lors, pouvons-nous penser que les justifications politiques ont auparavant empêché les États membres et l’Union européenne de prendre la décision activée la directive protection temporaire témoigne d’un certain racisme de l’Europe envers les réfugiés non-européens ?
Même si nous nous réjouissons de l’activation de cette directive, il faut reconnaître qu’elle aurait pu être particulièrement utile lors de bien d’autres afflux migratoires ayant eu lieu en Europe depuis 2001. Nous encourageons bien évidemment la rapidité et l’efficacité de l’accueil qui a été fait aux réfugiés ukrainiens, mais il faut également encourager à continuer de lutter pour que cet accueil puisse être possible pour tous les réfugié.e.s.
Sources
[1] loi du 18 février 2003 disponible sur https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-18-fevrier-2003_n2003000236.html
[2] https://www.cire.be/outil-pedagogique/le-reglement-dublin-quest-ce-que-cest-et-comment-ca-marche/#:~:text=Le%20but%20du%20R%C3%A8glement%20Dublin,plusieurs%20%C3%89tats%2C%20dont%20la%20Belgique.
UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nation, Treaty Series, vol. 189, p. 137, disponible sur https://www.refworld.org/docid:3be01b964.html
Global Citizen, “En Ukraine, des personnes noires dénoncent le racisme dont elles ont fait l’objet alors qu’elles tentent de fuir », publié le 28 février 2022, disponible sur https://www.globalcitizen.org/fr/content/racism-leave-ukraine-asylum-black-people-of-color/
CCFD Terre-Solidaire, « Ukraine : 5 questions autour de la directive de protection temporaire », publié le 25 mars 2022, disponible sur https://ccfd-terresolidaire.org/ukraine-5-questions-autour-de-la-directive-de-protection-temporaire/
Marine Buisson et Pierre-Yves Thienpont, « La double peine des étrangers qui fuient la guerre en Ukraine », Le Soir, publié le 28 février 2022, disponible sur https://www.lesoir.be/427141/article/2022-02-28/la-double-peine-des-etrangers-qui-fuient-la-guerre-en-ukraine
Forum Réfugiés, « Que prévoit la directive européenne de protection temporaire », publié le 8 avril 2020, disponible sur https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/681-que-prevoit-la-directive-europeenne-de-protection-temporaire
par Cyril Martin | Jan 16, 2024 | Articles, Racisme, Thèmes
Qu’est-ce que le racisme ?
Notre organisation orientée vers la lutte contre le racisme, il nous paraît ainsi évident de commencer par la question la plus fondamentale : qu’est-ce que le racisme ?
 Afin de comprendre au mieux ce phénomène, nous devons commencer par distinguer la notion de discrimination du racisme. Le premier terme se rapporte à l’action d’isoler, de distinguer et de traiter différemment certains individus, ou même un groupe entier par rapport aux autres. [2].
Afin de comprendre au mieux ce phénomène, nous devons commencer par distinguer la notion de discrimination du racisme. Le premier terme se rapporte à l’action d’isoler, de distinguer et de traiter différemment certains individus, ou même un groupe entier par rapport aux autres. [2].
La discrimination peut s’appuyer sur différents critères (âge, sexe, nationalité, race, etc). Il s’agit d’un concept large qui peut couvrir des actes racistes mais qui ne permet pas, à elle seule, de comprendre l’étendue du racisme. C’est pourquoi il est primordial de bien comprendre que ces deux notions présentent des similitudes mais ne sont pas identiques.
Le racisme, quant à lui, est fondé sur un ensemble de croyances ou de doctrines systématisées selon lesquelles il existe différentes races ainsi qu’un classement hiérarchique entre elles.
Le racisme ne se présente pas sous une seule et même forme. En effet, nous retrouvons généralement une distinction en fonction de l’adjectif qu’on lui accole : « scientifique», « institutionnel », « systémique », ou encore “ordinaire”
Le racisme scientifique

Le racisme communément appelé “scientifique” émerge avec l’objectif de classer les êtres humains en fonction de leurs caractéristiques phénotypiques telles que la couleur de peau, la taille du crâne, les traits du visage, etc [3].
Le racisme institutionnel et le racisme systémique
Bien que certains confondent souvent ces derniers, le racisme institutionnel se différencie du racisme systémique. Le racisme institutionnel est intégré dans le système politique, économique ,légal , ainsi que dans les relations professionnelles et académiques ( on le retrouve dans des systèmes comme l’apartheid ou encore la ségrégation) [4].
Le racisme systémique quant à lui vise les conduites racistes adoptées par ces mêmes institutions, en dehors d’un cadre légal ou procédural prédéfini. Il s’agit des inégalités de chances, des discriminations académiques, des discriminations face à la justice, de l’évaluation négative d’un groupe de personnes en raison de sa couleur de peau, etc. [5].
Le racisme ordinaire est direct, se caractérise par un discours haineux, du quotidien ou encore une « exagération des différences entre les cultures ou les systèmes de valeur ». Un exemple actuel est le cas de blackface. mais on le retrouve aussi dans l’imitation d’accent et tout autres stéréotypes.
Conclusion
En conclusion, en plus de la différence entre la notion de racisme et de discrimination, il existe plusieurs types de racismes. Il n’existe pas une échelle de gravité entre ces derniers. Chaque catégorie est la conséquence d’une autre. Chacune d’entre elles fait du mal à la personne qui la subit. C’est pour ça qu’avec Racism Search, nous avons comme but de sensibiliser le plus possible les gens sur cette thématique qui, au 21ème siècle, ne devrait plus exister.
Sources
[1] Larousse, disponible sur https://www.larousse.fr, consulté le 21 novembre 2020.
[2] Ahmed Lemligui, « Histoire d’un racisme au long cours. Quelques pistes pour un travailleur social », Le sociologue, 2011/1 (n°34), disponible sur www.cairn.info.be, p. 14.
[3] Ibid.
[4] Ahmed Lemligui, op.cit., p. 16 ; Florian Gulli, “Racisme institutionnel”, disponible https://lavamedia.be, 1er juillet 2020
[5] Fabrice Dhume, “Du racisme institutionnel à la discrimination systémique ? Reformuler l’approche critique”, Migrations Société 2016/1 (N° 163), disponible sur www.cairn.info.be, pp. 33-46.

par Cyril Martin | Jan 14, 2024 | Articles, History, Personnages
Les victoires collectives des femmes racisées
La journée internationale des luttes pour les droits des femmes (8 mars) est une journée qui permet de faire le bilan sur la situation des droits des femmes, de fêter les victoires, de lutter collectivement et de faire entendre une fois encore différentes revendications. En cette journée importante, donc, nous vous proposons un article qui revient sur certaines luttes collectives menées par des femmes racisées.
Si l’accent est mis ici sur les luttes collectives, plutôt que celles de personnalités, c’est pour éviter les écueils de la réécriture du récit militant ou des effacements d’une partie de celui-ci où certaines figures sont héroïsées après avoir été “pacifiées” selon les codes de la narration dominante (c’est-à-dire après avoir été séparées du mouvement et de la communauté dans lesquels leurs actions s’inscrivent, vidées de leur militantisme et radicalité) [1].
Cet article vous propose de revenir sur six luttes de six contextes géographiques et temporels différents avant de mettre en avant les différents aspects transversaux qui les traversent.
Les femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles
En juillet 2019, une trentaine de femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, toutes d’origine africaine, ont commencé à se mobiliser pour lutter contre leurs conditions de travail précaires. Elles ont dénoncé des conditions de travail déplorables: horaires de travail instables, salaires bas, charges de travail excessives, et pratiques de management oppressives et dégradantes. En effet, elles représentent une fraction des “salariées invisibles”: une main d’œuvre essentiellement féminine et racisée, systématiquement sous-payée, et assignée à des activités dévalorisantes. Le mouvement a rapidement gagné en force, avec des manifestations régulières et des grèves organisées par les travailleuses et leurs soutiens. Les actions des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont attiré l’attention des médias et ont suscité une solidarité croissante de la part du public ainsi que des partis politiques et figures de gauche. Les travailleuses ont également créé un comité de grève pour coordonner leurs actions et leur communication. Finalement, le 24 mai 2021, après presque 2 ans de mobilisation, les travailleuses ont obtenu certaines de leurs revendications, notamment une augmentation de salaire et une réduction de la charge de travail. Bien que leur lutte ait eu des répercussions positives, les femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ont continué à militer pour une amélioration des conditions de travail des travailleurs précaires dans l’industrie hôtelière. Pour faire écho à l’actualité, un mouvement similaire a vu le jour à Bruxelles en 2023, où “la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers” a déposé une pétition devant le Parlement de la Région Bruxelles-Capitale pour demander un dialogue sur cette question cruciale et revendiquer une meilleure considération de leur statut [2], [3], [4], [5].

Devant l’Ibis Clichy-Batignolles après la signature de l’accord. (Albert Facelly/Libération)
Le Groupe des Femmes Kanaks Exploitées et en Lutte (GFKEL)
Le groupe des femmes kanaks exploitées et en lutte est né dans les années 1980 en Nouvelle-Calédonie et vise à lutter à la fois contre la domination coloniale et contre la domination patriarcale, sans prioriser un combat au détriment de l’autre. Un trentaine de femmes cherche à s’organiser indépendamment car elles rencontrent de nombreuses résistances au sein même du mouvement nationaliste [6]. Actions de désobéissance civile, prises de parole dans les médias, implications politiques, elles ont mené pendant quatre ans un combat féministe radical pour que l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne se fasse pas tant que les femmes continueront à subir des injustices et des oppressions quotidiennes.
Las Madres de Plaza de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo est un mouvement lancé par le rassemblement de 14 mères sur la place de Mai à Buenos Aires, le 30 avril 1977. La réunion de ces femmes est un moyen de résister pacifiquement à la dictature militaire et à la répression en Argentine. C’est aussi un moyen de demander vérité et justice pour leurs enfants disparus, très probablement enlevés, torturés et assassinés par le régime au pouvoir. En effet, on estime à 30.000 le nombre de personnes disparues entre 1976 et 1983, date à laquelle la dictature prend fin. Le régime cherche à intimider et à réduire au silence les opposants politiques. Las Madres ont été les seules à s’opposer à l’armée et ont continué à réclamer que les agents de l’Etat soient traduits en justice après la chute du régime. Las Madres, rejointes également par las Abuelas (grand-mères) se réunissent toutes les semaines, le mouvement grossissant au fil des disparitions. Le mouvement a eu un impact significatif sur l’opinion publique en Argentine et dans le monde entier, en attirant l’attention sur les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement militaire argentin. Las Madres ont également contribué à faire avancer les enquêtes, en travaillant avec des organisations telles que le Centre d’études légales et sociales (CELS) et la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP). Ce mouvement fait écho à des associations actuelles de mères de quartiers populaires qui luttent contre les violences policières comme le “Front de mères” ou le “collectif des Madres”[7], [8], [9].

foto: Pablo Ernesto Piovano
Les femmes adivasies du Kerala
En 2002, plusieurs femmes adivasies de l’État du Kerala (Inde) ont réalisé des sit-ins et d’autres actions de désobéissance civile devant une usine Coca-cola implantée à Plachimada. Elles revendiquaient la fermeture de l’usine en raison des préjudices environnementaux et sociaux que l’activité intensive de l’entreprise occasionnait. En effet, la fabrication des différentes boissons gazeuses implique un besoin conséquent en eau (9 litres d’eau pour un litre de boisson) ce qui, pour suivre le rythme soutenu de la production, a impliqué de pomper des millions de litres d’eau dans des nappes phréatiques, réduisant drastiquement leur niveau [10]. De cette activité industrielle a également résulté une pollution importante de l’eau potable restante dont devait se contenter la population de la région ainsi que de l’engrais distribué par l’entreprise aux agriculteurs dont il a été par la suite prouvé qu’il contenait un fort taux de cadmium et de plomb [11]. Dépossédant et polluant la terre des populations autochtones et les privant ainsi de tout moyen de subsistance [12], un collectif de femmes adivasies s’est mobilisé pour revendiquer sa fermeture. Après plus d’un an d’actions, qui menèrent parfois à des arrestations et des violences policières [13], le conseil communal (Panchayat) a ordonné la fermeture de l’usine [14]. Cette victoire ne fut que de courte durée car une bataille judiciaire a fait rage pendant de nombreuses années, les différents tribunaux faisant primer parfois le droit de propriété de l’entreprise sur le droit à un environnement sain. Il a fallu attendre 2017 pour que Coca-cola cesse ses activités dans la région [15]. Cette lutte de longue haleine est désormais un symbole d’une lutte collective menée par des femmes autochtones pour des droits sociaux et environnementaux et de l’écoféminisme. Elles réclament maintenant une réparation de la part de Coca pour ces différents dommages.

Les femmes autochtones du Québec
L’association Femmes autochtones du Québec (FAQ) représente les femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain [16]. Créée en 1974, les femmes qui la composent ne cessent depuis lors de militer pour un meilleur accès aux droits dont les autochtones, en particulier les femmes, sont régulièrement privés. En particulier, nous avons fait le choix ici de faire le jour sur leur combat aux côtés des familles des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Si des recherches et décomptes avaient déjà été réalisés par le passé, c’est en 2014, avec le rapport de la Gendarmerie royale du Canada dénombrant 1181 femmes autochtones disparues ou assassinées depuis les années 80 [17], que la problématique des femmes autochtones disparues ou assassinées éclate aux yeux du monde. Si l’aspect systémique de ces disparitions/assassinats interpelle, c’est également leur traitement par les forces de l’ordre et la justice qui est pointé du doigt. En effet, celles-ci refusent de donner certaines informations aux familles, de poursuivre les enquêtes ou sont autrices de violences sexistes, sexuelles et racistes à l’égard des victimes et de leurs proches [18]. Travaillant sur la question des violences à l’égard des femmes depuis longtemps, la FAQ est bien décidée à ne pas laisser cette situation tomber dans l’oubli en mettant l’accent, au premier plan, sur le vécu des personnes concernées. Leurs actions sont diverses: elles publient des rapports pour informer et sensibiliser, elles réalisent des campagnes sur les réseaux sociaux [19], sont à l’initiative de la demande d’enquête parlementaire au niveau national (et l’ont obtenue), challengent la mise en place d’un plan fédéral sur la question pour qu’il soit ambitieux et réponde aux besoins des différents peuples des Premières Nations. Si leur lutte est loin d’être terminée, leurs modes d’action est une inspiration et le pouvoir et la reconnaissance qu’elles obtiennent progressivement une véritable victoire.
Les guerrières Agojié
Les Agojié (ou Mino) étaient des guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey (sud du Bénin actuel) entre le XVIème et XIXème siècle. Il s’agissait d’une unité d’élite exclusivement féminine, dont l’entrainement au combat débutait dès l’âge de 7 ans. Les Agojié, surnommées Amazones par les Européens, ont la réputation d’être des femmes emblématiques et redoutables au combat. Elles ont férocement combattu de nombreux ennemis ayant tenté d’envahir leur royaume, y compris des colonisateurs et esclavagistes. Leur puissance, leur talent et leur témérité ont permis de repousser tous les adversaires, fidèlement à leur devise: « vaincre ou mourir ». Ainsi, dans les années 1840, on estimait le nombre de femmes guerrières à 6000.
Cependant, en 1892, l’arrivée des forces coloniales des armées française et portugaise a causé la perte des Agojié. Les colons disposaient d’un armement considérable (fusils, revolvers) avec lequel les machettes et épées des Agojié ne pouvaient rivaliser. Au terme de plusieurs batailles, les Agojié sont réduites au nombre de 50. A la suite de leur défaite contre les colons, le Royaume du Dahomey est placé sous protectorat français en 1894, et l’armée des femmes prend fin. Mais leur histoire a eu un immense impact sur tout le continent, d’autant que les sociétés africaines étaient nombreuses à être matriarcales (terra).
Les guerrières Agojié ont inspiré le film The Woman King (Gina Prince-Bythewood), sorti au cinéma en septembre 2022 [20], [21], [22].

Image: Agojié vers 1890.
Importance de la lutte en collectif
Bien que les mouvements et les causes présentés soient très divers, l’importance de lutter en collectif est retrouvée partout. Dans toutes les luttes présentées, le fait d’agir à plusieurs, et avec d’autres femmes, a été crucial pour la réussite du combat. Risquant leur vie, leur emploi, évoluant dans des conditions précaires et affrontant une multitude d’obstacles, les femmes ont pu trouver du soutien parmi leurs pairs. Cela leur a permis de continuer leurs efforts, de ne pas se décourager et de voir plus loin que le risque d’échouer. Les femmes racisées sont particulièrement vulnérables et sujettes aux discriminations. Se mobiliser avec un groupe permet ainsi de mieux répondre aux détracteurs et de décupler l’impact des actions menées. Il est important de relever ici que les femmes racisées portent des luttes pour faire avancer leurs droits mais également ceux de toutes leurs communautés et donc des plus vulnérables que cela soit l’environnement, les personnes sans-papier, les victimes de violences sexuelles…En conclusion, l’on doit bien des victoires à des mouvements féministes et racisés. Le fait de mettre en valeur une individue au détriment du groupe délaisse l’aspect collectif alors qu’il est essentiel à la réussite de l’action. En cette journée du 8 mars, célébrons les groupes de femmes [23], l’adelphité, et continuons à lutter ensemble pour nos droits!
Sources
[1] Voy. l’exemple de Rosa Parks repris par Françoise Vergès dans: VERGES, F., Un féminisme décolonial, La fabrique Éditions, 2019, p. 92 et suiv.
[2] JEANNOT, G., “Après 22 mois de grève et un accord historique, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles racontent leur lutte "contre le patronat"”, France Info, 30 mai 2021, disponible sur: https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/temoignages-les-femmes-de-chambre-de-l-hotel-ibis-batignolles-racontent-leurs-22-mois-de-lutte-contre-le-patronat_4639771.html (consulté le 4 mars 2023).
[3] DURUPT, F. , “Femmes de chambres de l’Ibis Batignolles : la victoire après vingt-deux mois de combat”, Libération, 24 mai 2021, disponible sur: https://www.liberation.fr/economie/social/femmes-de-chambres-de-libis-batignolles-la-victoire-apres-vingt-deux-mois-de-combat-20210524_OXU7E4ERZRGD5LDXILGSMEBZJI/ (consulté le 4 mars 2023).
[4] FASSIN, E. et al., “Tribune. L’esclavage, c’est fini, même pour les femmes de chambre”, Libération, 9 mars 2020, disponible sur: https://www.liberation.fr/debats/2020/03/09/l-esclavage-c-est-fini-meme-pour-les-femmes-de-chambre_1781112/ (consulté le 4 mars 2023).
[5] Pétition citoyenne relative aux demandes de la Ligue des travailleuses domestiques sans-papiers, Parl. R. Bruxelles-Capitale, 11 janvier 2023, disponible sur: https://democratie.brussels/initiatives/i-152 (consultée le 5 mars 2023).
[6] SALOMON, C., « Quatre décennies de féminisme kanak », Mouvements, vol. 91, no. 3, 2017, pp. 55-66
[7] Voy. le site internet de l’association, disponible sur: https://madres.org/la-historia-de-las-madres/
[8] Voy. le site du Ministère de la Justice argentin, disponible sur: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/argentina-te-busca/abuelas-de-plaza-de-mayo
[9] Lauréate du Prix Sakharov de 1992, https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/las-madres-de-plaza-de-mayo-1992-argenti/products-details/20200330CAN54167
[10] SHIVA, V., “Les femmes du Kerala contre Coca-Cola”, Le Monde diplomatique, mars 2005, disponible sur: https://www.monde-diplomatique.fr/2005/03/SHIVA/11985 (consulté le 6 mars 2023).
[11] « L'actualité mois par mois », Pierre Jacquet éd., Regards sur la Terre 2007. L’annuel du développement durable. Énergie et changements climatiques. Presses de Sciences Po, 2006, pp. 30-53.
[12] RAJESH, K. P., “The Anti-Coca-Cola Movement in Plachimada, Kerala”, Journal of Developing Societies,2019, 35(4), 437-457.
[13] SUDHEESH, K. M., ““RESISTANCE FROM BELOW” An Assessment of The Struggle against Coca Cola Company in Plachimada, Kerala”, The Indian Journal of Political Science, 2009, 70(3), 839–852.
[14] X., “INDE. Coca-Cola contraint de fermer une usine”, Courrier International, 7 juillet 2014, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/2014/06/20/coca-cola-contraint-de-fermer-une-usine (consulté le 6 mars 2023).
[15] Raghunandan, G., “A Look at the Legal Issues Plachimada's Struggle for Water Against Coca-Cola Has Brought Up”, The Wire, 20 août 2017, disponible sur: https://thewire.in/law/coca-cola-plachimada-kerala-water (consulté le 6 mars 2023).
[16] Voy. le site internet de l’association, disponible sur : https://faq-qnw.org/a-propos/
[17] GRC, Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national, 2014, disponible sur: https://www.grc-rcmp.gc.ca/fr/les-femmes-autochtones-disparues-et-assassinees-un-apercu-operationnel-national (consulté le 6 mars 2023).
[18] BERGERON, A., BOILEAU, A. et LEVESQUE, C., Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec, FAQ, 2015.
[19] PILOTE, A.-M. et HUBNER, L.A., "Femmes autochtones et militantisme en ligne : usages de Facebook et Twitter pour contrer les violences sexuelles dans la foulée du scandale policier de Val-d’Or." Recherches féministes, volume 32, number 2, 2019, p. 167–196.
[20] LE JANNE, S., “Qui étaient vraiment les amazones du Dahomey, les guerrières de “The Woman King”?”, Courrier International, 28 septembre 2022, disponible sur: https://www.courrierinternational.com/article/cinema-qui-etaient-vraiment-les-amazones-du-dahomey-les-guerrieres-de-the-woman-king (consulté le 4 mars 2023).
[21] N’DIAYE, F., “Le zoom de Fatou N'Diaye sur les amazones du film "The Woman King", Terrafemina, 27 septembre 2022, disponible sur https://www.terrafemina.com/article/the-woman-king-qui-etaient-les-guerrieres-agojie_a366137/1 (consulté le 5 mars 2023).
[22] Wilkes, J., ‘Ces femmes guerrières d'élite béninoises qui sont devenues l'un des groupes les plus redoutables du XIXe siècle”, BBC, 1er novembre 2022, disponible sur https://www.bbc.com/afrique/articles/ce5g4y8dmz0o (consulté le 5 mars 2023).
[23] Nous utilisons le mot femmes pour englober toutes les personnes subissant ou ayant subi différentes formes de sexisme : les femmes cis, les femmes trans, ainsi que toutes les victimes de sexisme qui ne s'identifient pas en tant que femmes comme les personnes AFAB et les personnes non-binaires.
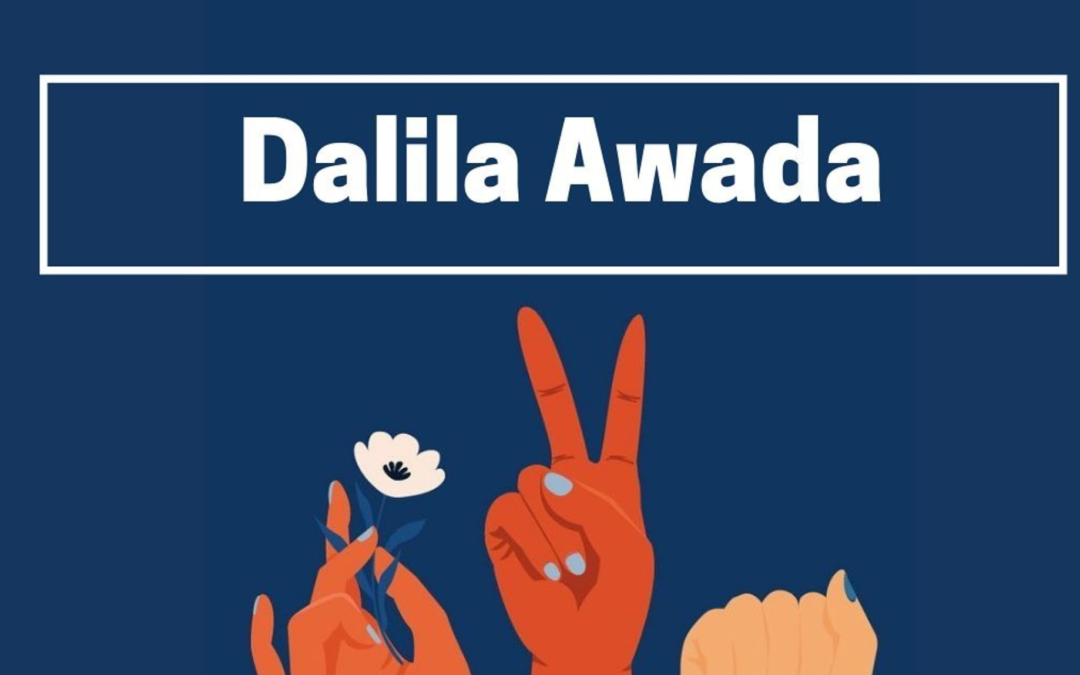
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Intersectionalité, Personnages
“[…] La personne de confession musulmane, érigée en ennemie, est un bouc-émissaire idéal. Paradoxalement, il rassure. Car nul besoin de se poser des questions sur nos propres façons de faire.”
Dalila Awada

Radio-Canada/Cécile Glabel, « Dalila Awada veut défendre ses idées pour le Québec », Radio-Canada Ohdiao, publié le 17.02.2019, disponible sur https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-gout-des-autres/segments/entrevue/106502/dalila-awada-feministe-racisme-idees
Née au Québec en 1990 de parents d’origine libanaise, Dalila Awada est une étudiante en maitrise en sociologie, féministe et militante. Elle est connue pour ses luttes pour l’acceptation du port du voile et contre le racisme. [1].
A 13 ans, Awada décide de porter le voile. Elle ressent ce geste comme une manière de mettre en avant ses valeurs, de s’intégrer à sa communauté et d’honorer sa religion [2]. Elle n’a jamais voulu choisir entre sa culture québécoise et libanaise et prône le fait qu’une balance entre les deux peut être possible, même lorsqu’on porte le voile [2]
Awada a connu, comme la plupart des femmes voilées, de nombreuses situations déplaisantes et racistes notamment dans la rue (où des passants ne manquaient pas de l’insulter ou la critiquer). Son entrée sur le marché du travail a également été marquée par un accueil froid et réservé à cause de son voile [2].
Elle se fait connaître durant le débat sur la Charte des valeurs québécoises dans lequel elle avait défendu le droit des femmes à porter le voile, dès 2013. Elle s’opposait dès lors à cette charte qui prévoyait la création d’une société laïque et interdisait le port de tout signe religieux visible (et ce, le port du voile, du turban, du hijab et de la kippah) pour tous les employés de l’Etat dans le cadre de leurs activités professionnelles [3][4].
Suite à ces propos, elle a fait face à des discours haineux. [5] Un certain blogueur du nom de Philippe Magnan s’est emparé du sujet et a attaqué la militante sur son site Poste de Veille. Il a, entre autres, fait un rapprochement entre l’islamisme radical et la position de Dalila. [6] En 2018, il doit verser 60.000 $ d’intérêts et frais de justice pour les torts causés par sa diffamation.[3]
Awada co-fonde également la fondation Paroles de Femmes qui a pour but d’offrir un espace aux femmes racisées pour s’exprimer et partager leurs expériences [1].
Awada Dalila est également chroniqueuse pour le magazine VOIR et conférencière [1] Elle écrit dans plusieurs journaux québécois, mais ne mentionne jamais sa relation à la religion. Elle préfère mettre en lumière et vulgariser la racisation des femmes et leurs droits. [5] Depuis 2018, elle est notamment chroniqueuse au sein du” journal Métro” qui est un quotidien montréalais [7]. On peut d’ailleurs y retrouver plusieurs articles qui ont un lien direct avec ses principales luttes.
Dalila Awada continue d’écrire et de lutter pour le féminisme et l’acceptation de chacun. Bien qu’installée de l’autre côté de la planète, les débats sur la Charte des valeurs québécoises sont assez similaires à ceux que nous pouvons retrouver sur notre continent et dans notre pays. Lorsque l’on connaît la multiplication des discriminations fondées sur la religion, réintroduire ce sujet au sein de la société semble évident, au Québec … et en Belgique.
Sources
[1] La Fondation Paroles de Femmes, disponible sur www.fondationparolesdefemmes.org.
[2] Montpetit, C., “Exposition- Ce qu’il y a derrière le voile”, disponible sur www.ledevoir.com, publié le 13 avril 2012.
[3]Bellemare, M., “Condamné pour diffamation, le blogueur Magnan doit verser 60 000$ à la militante Dalila Awada”, disponible sur www.journaldemontreal.com, publié le 13 juillet 2018.
[4] Dangenais, M., “La charte des valeurs québécoises”, disponible sur www.thecanadianencyclopedia.ca, publié le 23 janvier 2014.
[5] Le Monde de l’Autre, “Portrait de femme musulmane: Dalila Awada, militante et féministe” disponible sur https://lemondedelautre.org, publié le 29 novembre 2018.
[6] TVA Nouvelles. “Il savait que Dalila Awada n’est pas radicale”, disponible sur https://www.tvanouvelles.ca, publié le 9 mai 2014.
[7] Ferraris. F., “ le voile, pour ou contre ou ça dépend ? ”, disponible sur www.chatelaine.com.
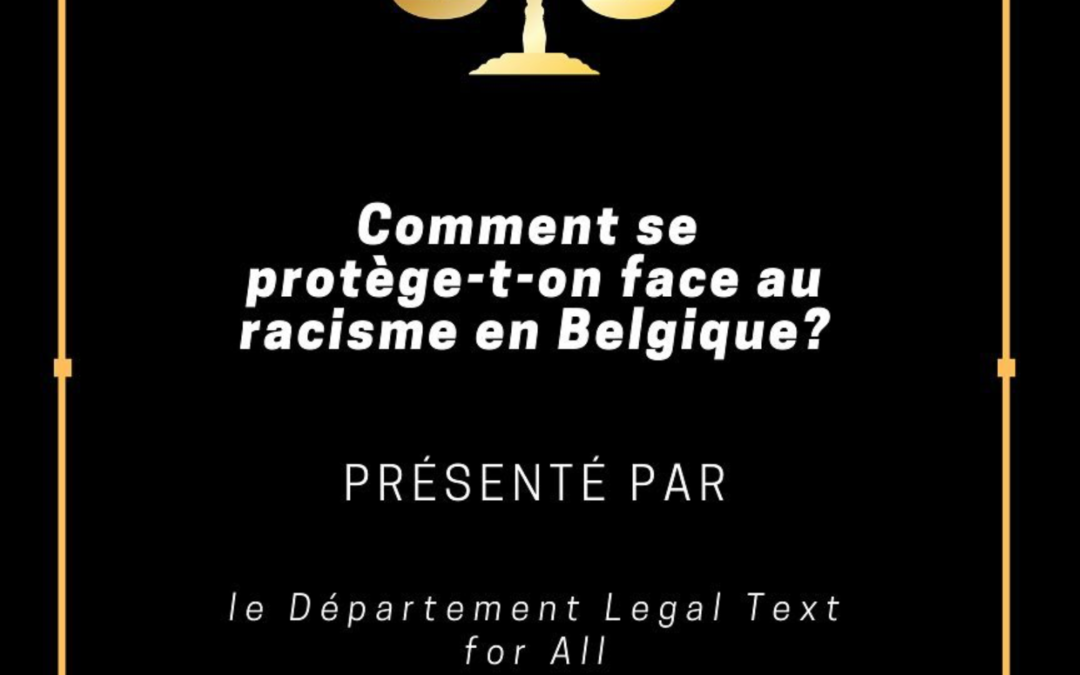
par racism-search | Jan 3, 2024 | Articles, Belgique, Droits, Legal Text For All
As-tu déjà été témoin ou personnellement confronté à des actes racistes ? T’es-tu déjà demandé sur quelle.s base.s juridiques tu pouvais agir pour assurer tes droits et libertés?
Nous allons aujourd’hui explorer, de manière simple, les règles générales nationales qui permettent de lutter contre le racisme en Belgique.
Mais avant tout, il est indispensable de comprendre qu’il existe des règles de droit plus fortes que d’autres. En effet, celles-ci sont organisées selon une pyramide des normes :

Sur base de ce schéma, l’Article 11 de la Constitution est plus « fort » que la loi anti-racisme et la loi anti-discrimination.
En matière de discrimination sur base de la race, cet article 11 à lui seul, ne peut pas faire grand-chose car il est souvent vu comme étant trop général ! Il est donc préférable d’appliquer, lors d’un litige, tant la Constitution que les lois qui concernent plus précisément la matière.
En réalité, il faut voir l’ensemble comme une multitude de moyens de défense. Plus tu en as, mieux c’est ! Mais encore faut-il être dans les conditions pour les appliquer…
La Constitution belge
Contenu et contexte historique :
L’Article 11 de la Constitution figure au sein du livre II de la Constitution, intitulé : « Les belges et leurs droits», et prévoit que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».
Cet article est ajouté lors de la troisième réforme d’Etat (1988) dans le cadre de l’extension des compétences de la Cour d’arbitrage (appelée aujourd’hui Cour constitutionnelle). Au départ, elle avait reçu pour mission de garantir cet article dans le cadre de l’enseignement. Mais au fur et à mesure, elle a imposé le respect de l’article 11 en toutes matières.
Qui peut invoquer l’Article 11 de la Constitution ?
- L’Article 11 t’indique son champ d’application personnel : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges… ». Il faut donc avoir la nationalité belge qui peut être attribuée dès la naissance ou acquise.
P.S. : Dans le dernier slide, tu retrouveras un petit dico des mots pointés en gras
La Loi anti-racisme du 30 juillet 1981 (Racial Equality Federal Act)
Cette loi a pour but d’apporter un cadre légal pour combattre de manière spécifique le racisme.
Elle vise plusieurs critères de discrimination, à savoir : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et la nationalité.
La loi antiracisme va protéger les personnes victimes de :
- discrimination directe
- discrimination indirecte
- injonction de discriminer
- harcèlement
Le savais-tu ?
Cette loi belge datant de 1981, a été révisée le 10 mai 2007 dans le but de transposer la directive européenne 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
Il est intéressant de noter que le législateur belge a rendu la loi belge plus extensible que ce que l’Union Européenne demandait.
- On trouve notamment le critère de nationalité dans la loi belge, alors que ce dernier est absent de la directive européenne.
- La Belgique a choisi d’inscrire le terme de “prétendue race” plutôt que de “race”.
En faisant ce choix, le législateur tend à mettre en avant le caractère péjoratif que peut avoir la notion de race, car cette notion peut avoir pour conséquence de découler sur une idéologie raciste.
Deux lois du 10 mai 2007 : la loi anti-discrimination et la loi sur l’égalité des genres
Ces deux lois ne visent pas la discrimination basée sur la race, étant donné qu’elle est déjà reprise dans la loi anti-racisme de 1981 qui vient d’être vue.
La loi anti-discrimination nous protège contre des discriminations fondées sur une multitude d’autres critères tels que l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.
La loi sur l’égalité de genre nous protège, quant à elle, contre les discriminations basées sur le sexe (l’expression de genre, le changement de sexe etc étant compris comme des distinctions sur base du sexe).
Les deux lois interdisent :
- la discrimination directe
- la discrimination indirecte
- l’injonction de discriminer
- le harcèlement
- le harcèlement sexuel (uniquement pour la loi sur l’égalité des genres)
- un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée (uniquement pour la loi anti-discrimination)
Le savais-tu ?
Tu te demandes pourquoi on te parle de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité des genres vu qu’elles ne visent pas le racisme ? Et bien elles ont tout de même une importance en cas de discrimination intersectionnelle, c’est à dire lorsqu’une personne est discriminée sur base de plusieurs critères à la fois. Il y a donc une intersection entre différents critères.
Par exemple, lorsqu’une femme noire voilée se voit refuser la location d’un logement parce le propriétaire est mysogine, raciste et qu’il pense que tous les musulmans sont des terroristes, et bien nous avons affaire à une discrimination intersectionnelle qui couvre, ici, 3 critères différents : le genre, la race et la conviction religieuse. Dans ce cas, il est donc intéressant d’utiliser les trois lois que nous venons d’expliciter.
– Dico juridique –
- Discrimination directe : vise le cas d’une personne qui est traitée de manière moins favorable qu’une autre en raison d’un des critères protégés par la loi.
Par exemple : je ne suis pas engagé dans un travail en raison de ma couleur de peau.
- Discrimination indirecte : vise le cas d’une situation qui, à première vue, paraît neutre mais qui est discriminatoire dans ses conséquences.
Par exemple : le fait d’interdire une prime à des salariés à temps partiel pourrait dans les faits priver majoritairement les femmes de cette prime et s’avérer discriminatoire, en sachant que 43,6 % des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 11,8 % d’hommes.
- Injonction de discriminer : tout comportement intentionnel consistant à imposer à quelqu’un de pratiquer une discrimination, sur la base d’au moins un des critères protégés, à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de l’un de leurs membres.
- Directive européenne : texte adopté par les institutions de l’Union européenne fixant des règles que les États membres doivent respecter, mais devant être transposées par les Etats membres dans leur droit national.
- Cour constitutionnelle (ancienne Cour d’arbitrage): Cour qui règle les conflits de compétence et veille à l’application de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution. Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage (http://www.vocabulairepolitique.be/).
Sources